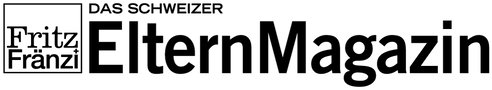«Les parents sont responsables de la qualité de la relation»
Martina Schmid conseille les mères et les pères qui ne savent plus quoi faireà l'association Elternnotruf. Elle sait que la violence psychologique peut entrer en jeu lorsque les parents ont des attentes irréalistes vis-à-vis de l'enfant ou lorsqu'ils lui font porter la responsabilité des sentiments parentaux.
Madame Schmid, quand la violence psychologique envers les enfants apparaît-elle ?
La violence psychologique survient souvent lorsque les parents se sentent impuissants ou dépassés, que leur niveau de stress augmente. Les problèmes de travail, les voisins, la pression du temps, les attentes envers soi-même ou les idées fixes sur la manière dont les choses devraient se dérouler correctement : Tout cela peut renforcer le stress dans des situations éducatives difficiles et mettre les parents sous pression. Le fait qu'ils parviennent à agir sans violence dépend en grande partie de leurs stratégies pour réguler le stress et les sentiments de surmenage, de leur capacité à établir des priorités - et de leurs attentes réalistes vis-à-vis de l'enfant.
Que voulez-vous dire ?
Je remarque par exemple que de nombreux parents attendent des jeunes enfants qu'ils soient capables de réguler leurs émotions et de contrôler leur comportement. Les jeunes enfants ne sont pas encore en mesure de classer et de gérer leurs émotions, ils ont besoin de parents qui les aident à s'exercer. Des attentes exagérées génèrent de l'impuissance. Les parents produisent le même effet lorsqu'ils insinuent que le petit enfant cherche délibérément à les énerver. Même s'ils en ont l'impression, l'enfant a particulièrement besoin de ses parents et ne veut certainement pas se les mettre à dos.

À quelle forme de violence psychologique êtes-vous souvent confronté(e) ?
Le fait que les parents crient sur leur enfant, l'humilient ou le menacent sont les formes de violence psychologique les plus répandues. Souvent, les parents appellent après des conflits destructeurs, lorsque les enfants dorment et que des sentiments de culpabilité apparaissent. En discutant, ils prennent parfois aussi conscience que leur comportement risque d'entraîner l'abandon de la relation avec l'enfant.
Qu'est-ce que cela signifie ?
Il arrive que les parents, par colère, déception ou surmenage, aient du mal à témoigner de l'affection et de l'attention à leur enfant dans les moments de conflit, parce qu'ils ont le sentiment que leurs efforts ne servent de toute façon à rien. Il arrive alors que les parents finissent par dire : «Fais ce que tu veux, tu ne nous écoutes pas de toute façon».
Qu'est-ce que cela fait à l'enfant ?
Lorsque les parents se retirent en tant que soutiens et piliers d'orientation, ils laissent l'enfant se débattre dans le vide. Cette forme de violence psychologique peut mettre en danger son développement. Même si les adolescents sont justement passés maîtres dans l'art de défier les parents sur le plan émotionnel et de leur donner le sentiment qu'ils peuvent se débrouiller sans eux - c'est le contraire qui se produit. L'adolescence fait partie des tâches de développement les plus difficiles et déstabilise les jeunes. Ils ont alors besoin de savoir qu'il y a quelqu'un en arrière-plan qui les regarde, qui reste présent et qui fait des propositions relationnelles.
Que faire si l'enfant les rejette ?
Cela peut arriver. L'essentiel est que les parents ne cessent pas de le faire. Une offre relationnelle ne doit pas nécessairement être une invitation à la discussion - on peut cuisiner à l'enfant son plat préféré ou lui demander s'il veut faire quelque chose. C'est pourquoi les choses ne s'arrangeront pas tout de suite, mais le message est clair : je suis là. Je m'intéresse à toi. Dans certaines phases, l'entretien des relations se fait effectivement à sens unique. Bien sûr, le rejet fait mal. Mais c'est à nous, parents, de trouver un moyen de gérer cette douleur - il n'est pas du ressort de l'enfant de ne pas nous offenser. Nous, parents, sommes responsables de la qualité de cette relation. La faire peser sur l'enfant en le rendant responsable de ses propres sentiments est une forme de violence psychologique.
Avez-vous un exemple ?
Je vois souvent des parents dire à leur enfant que cela les rend tristes si l'enfant n'obéit pas, par exemple. C'est différent de dire à l'enfant que l'on n'est pas d'accord avec son comportement. En revanche, si l'on force une coopération en faisant appel à sa mauvaise conscience vis-à-vis de la mère triste et en espérant, pour le consoler, qu'il cède, on pousse l'enfant dans un rôle qui le dépasse et le déstabilise émotionnellement à long terme. Pourtant, cette stratégie est très répandue, que ce soit dans les relations avec les enfants en bas âge ou dans les disputes concernant les devoirs.
Lors des devoirs, la massue verbale n'est souvent pas loin.
Oui, parce que les parents sont submergés par leurs propres émotions : l'impuissance face au fait que leur enfant ne remplit pas son devoir, l'inquiétude quant aux conséquences que cela pourrait avoir sur son avenir, et la honte face à la question de savoir comment on se situe en tant que parent face à l'enseignant. Cela conduit parfois à un surmenage total qui amène les parents à dévaloriser leur enfant, à le menacer ou à le gronder.
Les parents ne peuvent pas tout faire parfaitement. Être conciliant avec soi-même permet aussi de relâcher la pression.
Comment pourrait-on faire mieux ?
Parfois, il est utile de se demander ce qui pourrait être utile ou utile au lieu de se focaliser sur les attentes. Ainsi, il est souvent utile de procéder à de petits changements, par exemple de repenser le lieu et l'heure des devoirs ou d'accorder plus d'espace à l'agenda de l'enfant. Parfois, rien n'aide, du moins pas immédiatement.
Alors quoi ?
Je dois alors me demander si je dois m'engager dans une lutte permanente avec l'enfant ou si je dois opter pour un changement. Je peux par exemple essayer de laisser la responsabilité des devoirs là où elle doit être : à l'école. L'enfant y va alors sans devoirs ou dort mal parce qu'il n'a pas étudié.
Laisser un enfant faire des expériences négatives et en tirer des leçons ne signifie pas échouer en tant que parent. Il est toutefois conseillé d'informer l'enseignant de cette démarche. Prendre des décisions et clarifier les rôles peut faire baisser la pression. Je le dis aussi du point de vue de l'enseignant que j'ai été pendant longtemps. Certaines étapes de développement prennent du temps. Une attitude claire et une certaine confiance ont un effet puissant, même si l'enfant ne fait pas immédiatement ce que l'on attend de lui. Le message peut être le suivant : Il est important pour moi que tu apprennes à faire les choses, même si tu n'en as pas envie. Tu n'y arrives pas encore, mais nous y travaillons.
Supposons que des parents aient crié sur leur enfant, qu'ils l'aient rabaissé et qu'ils le regrettent. Comment procèdent-ils ?
On prend l'enfant à part dans un moment de calme et on lui dit : "Je n'ai pas bien agi avec toi. J'aurais préféré ne pas te crier dessus et je m'en excuse. L'enfant apprend ainsi comment les gens assument la responsabilité de leurs actes. L'éducation est parfois très exigeante. Les parents ne peuvent pas tout faire parfaitement. Ils ne doivent pas non plus le faire. Être conciliant avec soi-même permet aussi de relâcher la pression.
Quand les parents doivent-ils faire appel à une aide spécialisée ?
Lorsque le sentiment s'installe qu'ils se comportent envers l'enfant comme ils ne le souhaitent pas, mais qu'ils ont des difficultés à briser ces schémas. Chercher de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de responsabilité personnelle.