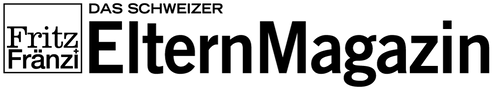«Les parents ne sont pas responsables de tout»
Madame Cina, l'éducation est aujourd'hui associée à différentes connotations. Qu'entendez-vous par là ?
L'objectif de l'éducation est la socialisation. Il s'agit pour les parents d'essayer de transmettre à l'enfant qui grandit ce dont il a besoin pour s'orienter dans son environnement. Que doit-il apprendre, quelles expériences doit-il faire ? La réponse à cette question détermine la direction que nous donnons à l'enfant - le comportement éducatif par lequel nous influençons son développement. Les parents choisissent différentes stratégies pour ce faire.
L'éducation doit avant tout permettre à l'enfant de devenir autonome.
Revenons tout de suite à la grande question : Qu'est-ce que l'enfant doit apprendre ?
Si nous examinons la question sous l'angle de la psychologie du développement, l'éducation devrait avant tout permettre à l'enfant de devenir autonome. Il doit un jour être en mesure d'organiser sa vie selon ses propres idées, en tant que membre de la société dans laquelle il vit. Pour cela, il a besoin de quelques compétences de base - des compétences de vie, pour ainsi dire.
Par exemple ?
Il y a tout d'abord les relations avec les autres. Cela présuppose des capacités de communication : puis-je m'exprimer de manière à ce que les autres me comprennent et défendent mes besoins ? Mais il s'agit aussi d'écouter l'autre : Suis-je capable d'écouter, d'enregistrer ce que l'on me dit et de le gérer si cela ne correspond pas à mon opinion ?

Notre capacité à nous débrouiller dans la vie est également liée à la manière dont nous gérons le stress et les défis. Il est plus facile de les surmonter lorsqu'un enfant a appris à classer les émotions difficiles et à les gérer de manière appropriée. Ses capacités de résolution de problèmes seront également sollicitées. Il s'agit de reconnaître les difficultés, d'y réagir et de persévérer lorsque la solution n'est pas évidente.
Comment enseigner cela aux enfants ?
En leur offrant un terrain d'exercice, en leur faisant vivre des expériences qui les aident à consolider de telles compétences de vie. Il n'y a pas de recette miracle, car chaque enfant est différent et apprend différemment. Pour les parents, le défi consiste à regarder attentivement qui ils ont en face d'eux et à adapter leur comportement éducatif en conséquence. Cela implique aussi de reconnaître que ce qui fonctionne pour les autres n'est peut-être pas applicable dans sa propre famille. Ce fait peut déstabiliser les parents.
On dit que l'insécurité marque la génération actuelle des parents comme jamais auparavant.
Il est clair que les questions d'éducation ne font plus l'unanimité comme il y a 50 ans, lorsqu'il existait un consensus social sur la manière de s'occuper d'un enfant. Aujourd'hui, les normes sociales sont beaucoup plus perméables, grâce aux développements sociaux mais aussi techniques. Au cours des dernières décennies, le monde a évolué plus rapidement que jamais, et le rythme s'est encore accéléré depuis le début du millénaire.
La réponse à la question de savoir ce dont un enfant a besoin comme bagage pour la vie est devenue plus complexe. Il suffit de penser à l'utilisation des médias numériques : qu'est-ce qui est juste et important ? Même la recherche est à la traîne sur ces questions. Si les parents sont inquiets, c'est certainement un phénomène de notre époque - mais pas seulement.
Mais alors ?
C'est aussi dans la nature des choses : l'éducation des enfants n'est pas facile. Ou seulement jusqu'à ce que des difficultés apparaissent. Que ce soit sous la forme de phases de développement difficiles, de problèmes émotionnels de l'enfant ou de pressions auxquelles il est confronté en dehors de la famille, par exemple à l'école ou dans le groupe de pairs. Dans ce cas, les choses ne se passent pas de manière optimale et les parents en déduisent généralement qu'elles ne vont pas bien. En d'autres termes, ils auraient dû s'y prendre autrement.
Nous ne devons pas attribuer tous les problèmes au foyer parental. Il y a aussi des facteurs qui entrent en jeu et sur lesquels les parents n'ont aucune influence.
Une erreur de jugement ?
Je ne le dirai jamais assez clairement : les parents ne sont pas responsables de tout. Ils ne peuvent pas tout contrôler. Nous savons que trois facteurs principaux influencent de manière déterminante le développement de l'enfant : sa prédisposition personnelle, le foyer familial et les influences environnementales. Et oui, des études ont montré à maintes reprises que le système familial dans lequel un enfant grandit joue un rôle important. C'est sa base, et si elle n'est pas bonne, les difficultés sont plus probables.
Mais nous ne devons pas en tirer la conclusion inverse - et attribuer tout problème au foyer parental. D'autant plus que, comme nous l'avons dit, deux autres facteurs entrent en jeu, sur lesquels les parents n'ont absolument aucune influence. Bien que la grande majorité des mères et des pères fassent du bon travail, on se focalise beaucoup sur leurs échecs - y compris les parents eux-mêmes.
L'un des reproches les plus fréquents faits aux parents d'aujourd'hui est qu'ils éduquent leurs enfants selon le principe du plaisir.
Dans mon travail, j'ai l'occasion de rencontrer des familles très différentes. Les parents qui donnent peu de directives à leurs enfants ne sont pas plus nombreux que ceux qui misent sur des règles strictes. Dans les deux cas, il s'agit toujours d'une décision consciente.

Je n'ai donc pas l'impression que les mères et les pères élèvent leurs enfants selon le principe du plaisir. Nous savons également par des études que la plupart d'entre eux sont très exigeants dans leur rôle de parents et qu'ils s'efforcent parfois presque trop de bien faire les choses. Mais il y a de grandes différences dans l'intensité de la direction parentale.
Où se situe la bonne mesure ?
La recherche montre que ni le style d'éducation autoritaire des années cinquante ni le principe du laisser-faire qui lui a succédé ne sont propices au développement de l'enfant. Un enfant à qui l'on dit constamment ce qu'il doit faire ne développera ni une saine estime de soi ni la responsabilité personnelle - celui qui peut faire ce qu'il veut sans jamais se heurter à des limites non plus.
Dans les deux cas, les enfants sont privés d'expériences d'apprentissage qui sont importantes pour leur relation avec eux-mêmes et avec les autres. L'éducation est une interaction entre l'attachement et la direction. L'attachement constitue la base : l'enfant se sent accepté et aimé par ses parents, il sait qu'il peut compter sur eux. Les enfants ont besoin d'être rassurés par leurs parents, mais ils ont également besoin de pouvoir s'orienter grâce à eux. Cela n'est possible que si les parents indiquent la direction à suivre. Cela implique parfois de faire comprendre clairement à l'enfant : Jusqu'ici et pas plus loin.
Actuellement, une autre approche est très en vogue : la relation plutôt que l'éducation.
Je trouve dommage de suggérer aux parents qu'il s'agit d'un «ou bien ou bien». De mon point de vue, les deux vont de pair. S'il n'y a pas de relation d'amour, l'éducation n'atteint pas son but : elle ne transmet pas à l'enfant quelque chose qui l'aide à trouver un bon chemin avec lui-même et son environnement. La relation seule ne suffit pas non plus.
Pourquoi pas ?
Parce que le chemin est semé d'embûches, d'adversités auxquelles un jeune est confronté. En tant que parents, il est de notre devoir de préparer l'enfant à cela, de lui faire faire l'expérience que la vie ne se déroule pas toujours comme il le souhaiterait. Un enfant réagit à la limitation de ses possibilités par la frustration. Mais si nous accompagnons sa colère, il apprendra à classer de tels sentiments et à trouver une manière de les gérer.
Les conflits peuvent également renforcer la relation parent-enfant.
Il essaiera différentes manières d'atteindre ses objectifs et apprendra, grâce aux interactions avec les autres, quelles stratégies sont utiles ou non. En tant que personnes de référence les plus proches, les parents ont le devoir de donner un feedback à l'enfant dans ce processus d'apprentissage. Cela implique parfois de fixer des limites et de résister. Les parents ont souvent du mal à le faire.
Comment l'expliquez-vous ?
Cela demande de l'énergie et les ressources ne sont pas inépuisables. Ce n'est pas grave si les parents ne sont pas cohérents à tous les niveaux. Cela devient problématique lorsqu'ils n'exigent pas les choses qui leur tiennent vraiment à cœur par peur des conflits. Si les parents ne supportent pas la résistance, ils cèdent le volant à l'enfant.
Cela ne leur vaut pas l'admiration de ce dernier, mais des discussions permanentes et épuisantes pour les nerfs, car l'enfant est dépassé par ce rôle. Il en résulte des systèmes familiaux très tendus, marqués par la frustration et l'impuissance. L'éducation va au-delà de la création de bons moments ensemble - c'est la direction dans les moments difficiles qui coûte de l'énergie. Mais : les conflits ont également le potentiel de renforcer la relation parent-enfant.
Les discussions qui ont pour seul but de convaincre l'enfant d'un point de vue contraire ne servent à rien.
Comment accompagner un enfant dans sa colère ?
En reflétant ses sentiments et en signalant sa compréhension : «Tu es en colère parce que tu aimerais bien une glace maintenant. Je peux le comprendre». Ce qui n'aide pas : insister sur la compréhension et faire de longues explications. De nombreux parents surestiment l'impact des mots.
De quelle manière ?
Ne vous méprenez pas : je ne suis pas contre les explications. Mais ces discussions qui ont pour seul but de convaincre l'enfant d'un point de vue contraire - elles n'apportent rien. Car l'enfant ne s'oppose pas par hasard, mais parce qu'il veut, comme nous, agir selon ses propres désirs. Et ceux-ci ne coïncident pas toujours avec ceux de l'autre. Les parents doivent l'accepter.
Il est alors souvent difficile pour les parents d'évaluer s'ils doivent négocier ou s'imposer.
La réponse à cette question dépend du sujet et de l'âge de l'enfant. Je ne négocierais pas l'heure du coucher avec un enfant de l'école primaire, même s'il estime qu'il est loin d'être fatigué - le lendemain, il n'aura pas dormi.
Ce qui est vraiment important pour les parents n'est pas négociable.
Ou des devoirs à la maison : La question de savoir s'ils doivent être faits ne se pose pas, mais on peut en revanche discuter du quand et du comment. Un enfant remarquera peut-être que cela l'aide de s'aérer d'abord la tête au lieu de s'asseoir immédiatement après l'école, ou qu'il apprend mieux en écoutant de la musique qu'en silence. Plus les enfants deviennent autonomes, plus ils devraient pouvoir prendre des décisions. Mais je dis aussi que ce qui est vraiment important pour les parents n'est pas négociable.
C'est là que les règles entrent en jeu - lesquelles sont utiles ?
Je conseille aux parents de se limiter à deux ou trois aspects qu'ils considèrent comme centraux. Dans de nombreuses familles, ces règles concernent les relations sociales, l'hygiène et l'ordre ou l'utilisation des médias numériques.
Par exemple, les règles peuvent être les suivantes : le mercredi soir, il faut faire le ménage parce que l'aide ménagère vient le jeudi, les smartphones n'ont pas leur place à table ou doivent être remis à partir de 22 heures. Les règles doivent aider à trouver une solution aux problèmes. Nous devrions les formuler en conséquence.
Des règles judicieuses n'ont pas pour but de créer des restrictions inutiles. Elles aident à structurer le quotidien commun.
A savoir ?
Si elles se présentent sous la forme d'une interdiction, les règles ont tendance à provoquer une résistance. Au lieu de prescrire ce que nous devons éviter, elles devraient montrer comment nous voulons nous comporter à la place. Les enfants un peu plus grands peuvent participer à la discussion sur de telles questions.
Il se peut qu'il y ait souvent des disputes bruyantes dans la famille. On pourrait alors dire : on ne crie pas. Une formulation positive serait plus utile : nous nous efforçons de garder un ton calme. Des règles sensées ne visent pas à imposer des restrictions, elles aident à structurer le quotidien commun et visent à protéger l'enfant.
Mais parfois, les jeunes ne respectent pas les accords.
Supposons qu'un enfant de l'école primaire ne rentre pas à midi à l'heure convenue. Tout d'abord, on peut s'enquérir de la raison de son retard. Il est possible qu'il ait voulu bavarder un peu plus longtemps sur le chemin.
Une possibilité peut être de tenir compte de ce besoin et d'ajuster l'accord : peut-être fixera-t-on à l'avenir l'heure du repas dix minutes plus tard. Il est important de faire comprendre à l'enfant qu'il doit les respecter, car sinon les parents s'inquiètent. Les règles agissent comme une sorte de barrière protectrice qui entoure l'enfant - parfois, il les franchira tout simplement. Cela en fait partie.
Renforcer un comportement par la reconnaissance est bien plus efficace que de vouloir le changer par la critique.
Alors quoi ?
Son action a alors des conséquences. Si l'enfant n'arrive pas à midi à l'heure pour le repas, les vingt minutes de retard peuvent par exemple être déduites de l'après-midi sans école. Il doit alors rentrer à la maison plus tôt le soir. Si cela ne fonctionne pas, la conséquence logique est renforcée - mon enfant ne pourra pas aller jouer avec ses amis. Mais les restrictions doivent toujours être conçues de manière à donner à l'enfant la possibilité de bien faire son travail.
Expliquez.
Il serait par exemple inutile de priver l'enfant de sortie pendant une semaine. L'enfant n'a alors ni l'occasion ni l'envie de recommencer. Il n'apprend rien. Les conséquences judicieuses sont des interventions courtes, tout à fait perceptibles, qui interviennent de manière ponctuelle : Si l'enfant en question arrive à nouveau à l'heure pour le déjeuner le lendemain, l'affaire est réglée et la conséquence annulée. Il faut alors aussi faire savoir à l'enfant : C'est super que tu aies respecté notre accord et que je puisse te faire confiance.
De manière générale, nous devrions essayer de féliciter plus souvent les enfants pour ce qu'ils font bien, plutôt que de nous focaliser sur les points de discorde. La fille adolescente a-t-elle nettoyé le lave-vaisselle sans qu'on le lui demande ? Remercions-la plutôt que d'en prendre acte sans rien dire. Encourager un comportement en le reconnaissant est bien plus efficace que de vouloir le changer en le critiquant.
Les critiques reprochent à la notion de conséquence d'être du vieux vin dans de nouvelles outres, c'est-à-dire un autre mot pour la punition.
Autrefois, la notion de punition était courante dans les sciences de l'éducation et la psychologie. Aujourd'hui, la punition et les concepts qui y sont liés sont considérés comme dépassés dans les deux disciplines. En revanche, la notion de conséquence est issue de la recherche actuelle - la présenter comme un substitut à la punition est trop réducteur.
Pourquoi ?
Parce que l'accent est mis sur un autre contenu. Dans le cas de la punition, il s'agit de faire pénitence, l'accent est mis sur la culpabilité, l'expiation, les sanctions ou les interdictions qui doivent être respectées uniquement par principe. Chez l'enfant, de telles mesures provoquent un sentiment d'impuissance, de culpabilité et souvent aussi de vengeance.
Les conséquences, en revanche, ne visent pas à rétablir la justice ou une position de force, elles ont pour but un processus d'apprentissage : nous laissons les enfants expérimenter les conséquences de leurs actes afin qu'ils apprennent progressivement à en assumer la responsabilité. Si un enfant traîne pour se brosser les dents, ne se prépare pas à aller au lit et laisse passer autant de temps, une histoire écourtée pour le coucher n'est pas une punition, mais la conséquence du fait qu'il n'y a justement pas assez de temps pour tout.
Et pourtant, elle repose sur un déséquilibre de pouvoir : on veut inciter l'enfant à adopter un comportement que l'on juge soi-même souhaitable.
Tout à fait correct - mais c'est l'éducation. Nous en revenons à la question initiale : que doivent apprendre nos enfants à la maison pour la vie ? De nombreuses compétences que tous les parents souhaitent probablement pour leur enfant ne s'acquièrent pas de manière autonome. Et pour cela, il a besoin non seulement de l'amour de ses parents, mais aussi de leur direction.