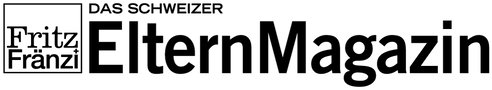Les parents dans l'impasse
«Mais je veux...», disions-nous quand nous étions enfants. «Nous savons mieux que quiconque ce qui est bon pour toi», répondaient nos parents, exprimant ainsi l'absolutisme éclairé qui caractérisait la vie de nombreuses familles. Depuis, les choses ont changé. En tant que thérapeute, je rencontre souvent des familles dans lesquelles les parents ont plus ou moins abandonné et où les enfants ont pris le pouvoir. Pourtant, les enfants ne sont pas du tout obnubilés par le pouvoir. Mais que signifient au juste pouvoir et responsabilité au sein de la famille ?
Les parents sont responsables
La responsabilité au sein de la famille incombe clairement aux parents jusqu'à ce que les enfants atteignent un âge d'environ 14 à 16 ans. Les parents sont les seuls responsables de l'atmosphère familiale, c'est-à-dire du ton avec lequel les enfants se parlent et se parlent, ainsi que de la manière dont les conflits sont résolus et les décisions prises. Les enfants n'ont aucune compétence ni expérience dans ces domaines et il n'y a jamais rien de bon à laisser les enfants en prendre la responsabilité.
Bien sûr, les enfants sont des observateurs avisés et défendent des points de vue constructifs - très souvent même -, mais c'est aux parents de mettre en place des processus qui sont justes et appropriés pour la famille. Le pouvoir au sein de la famille repose également sur les épaules des adultes. Non seulement en ce qui concerne des aspects tels que les finances, le lieu de résidence, les horaires de travail et la garde des enfants, mais aussi les décisions qui sont prises. En d'autres termes, la responsabilité est liée aux processus, le pouvoir aux contenus.
Le pouvoir est ce que l'on décide, et la responsabilité s'exerce par la manière dont les décisions sont prises. Sur le long terme, la qualité des décisions prises au sein de la famille dépend de la qualité du processus décisionnel. On pourrait donc aussi dire que la santé et le bien-être de l'ensemble de la famille dépendent presque entièrement du processus et non, comme la plupart le croient, du contenu.
Ce qui est décisif, ce ne sont pas les règles qui s'appliquent, mais la manière dont les adultes les introduisent et les gèrent.
Il ne s'agit pas de savoir si les enfants regardent la télévision une, deux ou cinq heures par jour, s'ils peuvent manger des sucreries ou non, s'ils doivent rentrer à la maison à 21 ou 23 heures ou quelle est l'importance des devoirs. Ce qui est déterminant, c'est plutôt la manière dont ces règles et ces directives sont introduites et gérées par les adultes.
De nombreux parents essaient par exemple d'éduquer leurs enfants à agir de manière responsable en les contrôlant en permanence. Mais cette méthode échoue presque toujours. Au lieu de cela, les enfants deviennent des experts dans l'art de se soustraire au contrôle permanent de leurs parents, ce qui amène ces derniers à se plaindre de devoir «tout dire cent fois».
La cause réside dans le fait que le processus et le contenu sont contradictoires. C'est comme si on disait : «Je veux que tu prennes tes responsabilités, c'est pourquoi je te contrôle tout le temps». Une contradiction mentale qui demande beaucoup d'énergie et laisse les deux parties perplexes.
Le poids de la décision
Il existe des familles dans lesquelles les enfants détiennent sans aucun doute une grande partie du pouvoir. Dans lesquelles ils décident en grande partie du sort de la famille, ce qui entraîne une lutte de pouvoir épuisante entre parents et enfants. Un exemple : Finn ne veut pas aller à l'école. Il a onze ans et vit avec sa mère et son frère de six ans. La mère s'est mariée tôt, son mariage s'est brisé peu après la naissance de son deuxième enfant. Son mari buvait beaucoup et était violent avec sa femme et ses enfants.
Au cours des quatre dernières années, le comportement de Finn est devenu de plus en plus difficile. Il est souvent agressif envers son petit frère. Il ne fait que rarement ce que sa mère lui demande. Lorsqu'elle essaie d'imposer sa volonté, il se met à crier et à détruire des objets. Pour couronner le tout, il refuse d'aller à l'école depuis six mois, sans donner de raisons précises. Jusqu'alors, il avait été un bon élève, qui aimait aller à l'école.
Un enfant souhaite une mère qui assume des responsabilités d'une manière qui lui permette d'être un enfant.
On pourrait alors penser que Finn a pris le pouvoir dans la famille, mais ce n'est pas le cas. Au contraire, la mère n'a jamais réussi à assumer ses responsabilités. Elle était mariée à un homme qui détenait tous les pouvoirs et qui appelait cela la responsabilité.
Chaque fois qu'elle essayait d'assumer elle-même des responsabilités, par exemple en matière d'éducation des enfants, il la marginalisait. Elle a toujours eu peur des conflits, car elle n'a jamais appris à les résoudre. En même temps, elle trouvait son mari trop sévère, aurait aimé donner à ses enfants plus de liberté et une éducation plus douce. Lorsqu'elle est maintenant invitée par sa sœur et qu'elle demande à Finn s'il a envie de rendre visite à sa tante, il répond sans hésiter «nö».
Non comme symptôme
Quand Finn était plus jeune, il coopérait volontiers. Mais au fil du temps, le «non» est devenu sa réponse par défaut, et les nombreux petits «non» se sont combinés en un grand «non» à l'école, impossible à ignorer - ce qu'on appelle la phobie scolaire. Pourtant, rares sont les phobies scolaires qui ont un rapport avec l'école. Finn refuse d'aller à l'école pour différentes raisons. Les deux plus importantes sont décrites plus en détail ci-dessous :
- Sa mère attache beaucoup d'importance à l'école. Elle l'aide chaque jour à faire ses devoirs, lui parle beaucoup de l'école et exprime toujours l'importance qu'elle accorde au fait qu'il s'y débrouille bien. A cet égard, Finn se comporte comme de nombreux autres enfants qui développent des symptômes dans les domaines que les parents perçoivent également avec certitude.
- Comme tous les premiers-nés de parents célibataires, Finn porte une grande responsabilité. Les enfants dans cette situation se sentent beaucoup plus responsables du bien-être de leur mère ou de leur père que la plupart des gens ne peuvent l'imaginer. A cela s'ajoute le fait que sa mère lui fait porter, sans le savoir, la responsabilité des décisions qui concernent sa famille. Sa relation avec son mari a été marquée par un manque d'autonomie et, bien qu'elle soit désormais plus âgée et plus expérimentée, elle laisse encore de nombreuses décisions à «l'homme de la maison».
A première vue, ce lien ne saute pas aux yeux. Les idées de la mère concernant l'éducation des enfants ressemblent à s'y méprendre à une attitude démocratique, accommodante et flexible. La plupart des gens la féliciteraient pour cette attitude, mais sa peur des conflits - qui ne cesse de croître à mesure que ceux-ci se multiplient - diminue considérablement la qualité du processus. Par conséquent, Finn doit assumer une responsabilité bien plus grande que ce qui est bon pour lui. Sa «phobie scolaire» signifie entre autres choses «Je suis responsable de ma mère. Cela me pèse tellement que je ne peux pas aller à l'école en plus».
De nombreux parents tentent d'éduquer leurs enfants à la responsabilité personnelle en les contrôlant en permanence. Cette méthode échoue presque toujours.
Mais pourquoi Finn dit-il si souvent non ? Il souhaite avant tout une mère qui assume ses responsabilités. Qui a le courage d'annoncer la couleur. Une mère contre laquelle il peut se frotter, grâce à laquelle il peut se développer. Ce qui ne signifie en aucun cas qu'il souhaite une mère autoritaire, qui édicte des règles strictes pour tout et les fait appliquer sans compromis. Mais il veut une mère qui assume ses responsabilités et celles de sa famille d'une manière qui lui permette d'être un enfant. Bien entendu, Finn se trouve face à un dilemme. En effet, les enfants de son âge ne sont pas encore en mesure de trouver les mots justes pour décrire le processus en cours dans leur famille.
Finn ne peut pas aller voir sa mère et lui dire : «Écoute, maman. C'est bien que tu veuilles avoir mon avis, mais je ne suis pas encore assez grand pour prendre des décisions pour notre famille. En fin de compte, c'est toi qui dois assumer cette responsabilité. Si c'est trop difficile pour toi seule, tu devrais demander l'aide d'un deuxième adulte».
Comme tous les enfants, Finn ne peut pas dire non au procès, mais seulement à son contenu. Et si sa mère n'est pas en mesure d'entendre ce non et de l'interpréter correctement, il doit le répéter de plus en plus souvent et de plus en plus fort - dans l'espoir qu'elle finisse par comprendre ce qu'il veut lui dire. La situation de Finn est grave, et malheureusement, les enfants dans sa situation évoluent trop souvent dans une direction destructrice, deviennent de petits dictateurs à la maison et à l'école ou tournent leur frustration vers l'intérieur et deviennent autodestructeurs.
Ce n'est pas une question de pouvoir
On conseille souvent aux parents, comme la mère de Finn, d'établir des limites plus strictes. Mais aussi compréhensible que ce conseil puisse paraître, il est presque invariablement voué à l'échec, car il met l'accent sur la lutte pour le pouvoir au sein de la famille. Or, le véritable conflit n'est pas lié au pouvoir, mais à la responsabilité, ce qui fait que la lutte pour le pouvoir est plus acharnée que jamais. C'est certainement une bonne idée de poser des limites là où elles faisaient défaut auparavant. Mais il faut d'abord aider les parents à assumer leurs responsabilités. Sinon, il peut arriver trop facilement que leur enfant doive également veiller au respect des limites et que le processus de création de symptômes au sein de la famille soit renforcé.
La forme sous laquelle les parents assument leurs responsabilités et les limites nécessaires varient d'une famille à l'autre. Cela dépend des normes et des valeurs des adultes. Dans tous les cas, c'est déjà un grand soulagement pour les enfants lorsque leurs parents cessent de prétendre qu'ils ne peuvent pas les contrôler, mais demandent de l'aide et disent : "Nous voulons apprendre à être responsables de notre famille de manière constructive.
Titre original «Når børn får ansvaret». Traduit par Knut Krüger, juillet 2021