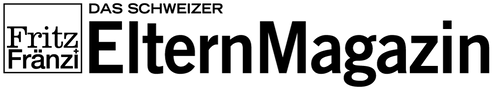Si tu es gentil maintenant, alors ...
Récemment, j'ai récompensé mon fils. Un dimanche matin, l'enfant de sept ans a pu aller seul à la boulangerie chercher des petits pains pour nous. Pour s'y rendre, il faut traverser une rue qui n'est pas équipée de feux pour piétons. Les automobilistes y respectent rarement les limitations de vitesse. Pendant longtemps, j'ai trouvé cela assez délicat. Mon fils trouve depuis assez longtemps que c'est «tout un bébé».
Il voulait absolument y aller seul. Ce dimanche matin, j'ai donné la priorité à son désir, avec des palpitations, il est vrai. Lorsqu'il est rentré à la maison, il était visiblement fier et très joyeux. Je lui ai glissé quelques petites pièces de la monnaie dans la main et lui ai dit : «Pour ta tirelire».
Pourquoi est-ce que je raconte cette histoire assez banale ? Parce qu'elle illustre à merveille l'effet involontaire que peut avoir une telle récompense. Sur le moment, je n'avais pas vraiment réfléchi à l'utilité pédagogique de ce petit geste. Mais le dimanche suivant, lorsque j'ai demandé à l'enfant de sept ans s'il voulait retourner à la boulangerie, il m'a demandé : «Est-ce que j'aurai de l'argent ?» Lorsque j'ai répondu par la négative, surprise, il n'était plus intéressé. Le week-end suivant, ce fut la même chose. Et c'en était fini de sa fierté d'être plus indépendant et de son désir de longue date d'aller faire ses courses seul !
«Sa récompense a entraîné une superposition de motivations», m'explique Albert Düggeli, professeur principal de psychologie pédagogique à la Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse. En fait, mon fils était motivé intrinsèquement, c'est-à-dire par son propre désir de suivre cette voie, d'être autonome et de faire ses preuves. Mais avec le deal de l'argent résiduel, quelque chose se superpose ici". Au lieu de recevoir une reconnaissance pour sa performance en tant que garçon responsable, il y a une allocation matérielle. Cette motivation extrinsèque, la récompense de l'extérieur, est plus forte que la motivation intrinsèque".
Les récompenses libèrent des hormones du bonheur
La raison de ce phénomène peut s'expliquer neurologiquement : Les récompenses libèrent des endorphines dans le cerveau des enfants. Ces hormones provoquent un sentiment de bonheur à court terme qui rend dépendant et qui exige ensuite une confirmation permanente de l'extérieur. «C'est aussi une observation que l'on a faite dans l'éducation scolaire», ajoute Albert Düggeli. "Au début de leur carrière scolaire, de nombreux enfants sont très motivés et veulent absolument apprendre à compter et à écrire. Ils ont remarqué que les grands peuvent le faire et sont motivés par la chose.
Ensuite, ils découvrent le système des smileys de récompense, des autocollants et de l'évaluation du comportement. D'abord, ils se demandent avec surprise pourquoi ils sont récompensés. Ensuite, le besoin d'une autre récompense prend souvent le pas sur l'intérêt initial pour la chose". En science, on appelle également cette conséquence involontaire de la récompense l'effet de corruption. Dans ce cas, la motivation interne à faire quelque chose est remplacée par une motivation externe.

La carotte et le bâton
Les récompenses dans l'éducation sont-elles donc une erreur ? Ne sont-elles pas utiles parce qu'elles renforcent un comportement positif ? C'est en tout cas l'hypothèse avec laquelle j'ai été éduqué, et avec moi sans doute beaucoup d'autres de la génération actuelle des parents.
Peu avant sa mort, le thérapeute familial danois Jesper Juul a constaté que la génération actuelle de parents avait davantage démocratisé la relation avec leurs enfants. «Au fil du temps, nous avons rendu la manipulation de nos enfants de plus en plus douce», écrivait-il. Cela ne signifie pas pour autant que les récompenses et les punitions en tant que méthodes - qu'il qualifiait de «carotte et de bâton» - ont fait leur temps.
Mais les punitions sont aujourd'hui souvent appelées «conséquences» ou «réactions conséquentes à un comportement fautif».
Albert Düggeli, psychologue du développement
Dans la vie quotidienne de nombreuses familles, les punitions, y compris physiques, continuent de jouer un rôle non négligeable. C'est ce que démontre notamment une étude de l'Institut de recherche sur la famille de l'Université de Fribourg. «Mais les punitions sont aujourd'hui souvent désignées comme des «conséquences» ou des «réactions conséquentes à un mauvais comportement»», explique le psychologue du développement Albert Düggeli. Cela sonne peut-être mieux, mais ne signifie finalement rien d'autre.
J'ai pu observer l'été dernier à la piscine en plein air à quel point cette menace de «comportement conséquent» peut avoir des conséquences désagréables. Un garçon d'environ huit ans a plongé à plusieurs reprises sa jeune sœur sous l'eau. Celle-ci a d'abord ri, puis a protesté bruyamment. À un moment donné, le père a dit : «Arrête, sinon je vais te montrer ce que c'est». Puis il a ajouté : «Dernier avertissement». Lorsque son fils a de nouveau immergé sa sœur, le père a sauté dans le bassin et a poussé le garçon qui se débattait violemment sous l'eau. Lorsqu'il le laissa remonter à la surface, son fils sanglota bruyamment. Sa sœur criait. Et le père avait lui aussi l'air d'avoir envie de pleurer. C'était un drame. L'histoire aurait peut-être été différente si le père avait dit : «Joue gentiment avec ta sœur et tu auras une glace après».
La récompense est-elle préférable à la punition ?
Les récompenses ont pour but de stimuler l'enfant et de lui montrer quel type d'interaction ou de comportement est socialement considéré. Les récompenses dans l'éducation ne sont-elles donc pas une meilleure alternative aux punitions ? D'autant plus qu'elles font également partie de notre monde professionnel : Qu'est-ce qu'un bonus sinon une récompense ? Et un sondage de l'institut d'études de marché Sotomo a récemment montré que 31% des parents suisses récompensent les bonnes notes, l'assiduité scolaire et un comportement exemplaire par une augmentation de l'argent de poche.
Si l'on discute de ces méthodes avec des psychologues du développement ou des pédagogues, on constate rapidement que les experts en éducation sont presque unanimes : les deux ne sont pas vraiment utiles. Les deux stratégies ont en commun le fait qu'elles permettent aux parents - ou à d'autres adultes de référence - d'exiger quelque chose des enfants et, en contrepartie, de leur permettre, de leur offrir, de leur interdire ou de leur retirer quelque chose.
Que cela soit souvent efficace, personne n'en doute. Il est étonnant de voir avec quelle rapidité un simple ourson en gomme peut convaincre un enfant de maternelle de mettre une veste pour laquelle il avait auparavant râlé pendant une demi-heure.

«Si tu te tais maintenant, tu auras une autre glace tout à l'heure». «Si tu n'arrêtes pas de tripoter ton portable, je le confisque». «Si tu ne participes pas, tu auras un temps mort dans ta chambre». «Si tu ne fais pas d'histoires en te brossant les dents, je te lirai une autre histoire». Qui ne connaît pas de telles phrases ou des si-alors similaires ? Dans ces moments-là, les parents ne sont peut-être pas particulièrement fiers de leur approche pédagogique, au contraire, ils se sentent souvent impuissants. Mais l'hypothèse de base est la suivante : parfois, il n'y a pas d'autre solution.
Les enfants doivent fonctionner
Pour la psychologue Nadine Zimet, il s'agit d'une erreur d'appréciation tragique. Bien sûr qu'il est possible de faire autrement. Et cela devrait l'être. «Il faut d'abord comprendre quelle attitude se cache derrière les deux méthodes», explique la thérapeute comportementale et formatrice en communication non violente, qui dirige à Zurich le Centre pour l'encouragement des talents. Elle y conseille et forme les parents au concept d'éducation non punitive.
Récompenser et punir reposent sur le même principe manipulateur. Les critiques les plus virulents affirment que nous récompensons l'obéissance.
«Les enfants doivent fonctionner. Ne pas faire de travail. Qu'ils obéissent à leurs parents. Que ça marche, tout simplement». Les deux méthodes reposent sur le même principe manipulateur : avec une punition, nous menaçons un enfant de le rendre délibérément malheureux pour qu'il change de comportement. Avec une récompense, nous récompensons un comportement souhaité. Les critiques sévères affirment que nous récompensons la docilité ou l'obéissance. Nous ne nous préoccupons pas de savoir si nous forçons notre enfant à faire quelque chose et si nous le poussons dans une norme qui ne lui correspond pas. Il est remarquable que l'idée de base derrière ces méthodes remonte à la théorie du behaviorisme : la forme de contrôle du comportement qui a été expérimentée à la fin du 19e siècle sur des chiens, des pigeons et des chimpanzés.
Récompenser et punir nuit à la relation
«Jamais nous ne nous comporterions ainsi avec un ami ou une amie», explique Nadine Zimet. «Ce qui se cache derrière cela, c'est que les parents ne traitent pas leurs enfants d'égal à égal. Ils se considèrent hiérarchiquement au-dessus d'eux». La psychologue connaît l'objection qui est souvent faite à ce stade : Les parents doivent tout de même apprendre à leurs enfants ce qui est bien et ce qui est mal. Sinon, comment un enfant de trois ans peut-il apprendre qu'il ne doit pas voler de jouets à son ami ? Comment un enfant de 13 ans peut-il savoir quelles sont les règles de politesse à respecter sur les réseaux sociaux ? Et qu'il n'est pas correct de poster des photos de ses amies sur Instagram ?

«Bien sûr, les parents sont supérieurs à leurs enfants en termes d'expérience de vie», déclare Nadine Zimet. «Mais en tant que personnalités, les adultes et les jeunes devraient se rencontrer sur un pied d'égalité». Selon elle, ce n'est pas le cas avec les deux méthodes. «Les parents abusent alors de leur pouvoir de manière manipulatrice».
L'auteur et chercheur en sciences sociales américain Alfie Kohn est l'un des critiques les plus radicaux de ce système d'éducation. Dans son livre «Liebe und Eigenständigkeit. L'art de la parentalité inconditionnelle, au-delà des récompenses et des punitions», il argumente sur trois bonnes centaines de pages que ces deux pratiques devraient être bannies du quotidien familial. Il affirme qu'elles nuisent avant tout à la relation parent-enfant. «Elles signalent aux enfants que l'amour parental est lié à des conditions». Même si ce n'est pas du tout le cas, estime Alfie Kohn, c'est le message qui passe auprès des enfants.
Il s'agit d'une prise de conscience, pas d'un succès à court terme
«En outre, ces mesures n'ont pas l'effet que les parents espèrent», explique Nuša Sager, psychothérapeute à l'Institut Klaus Grawe de Zurich. Finalement, l'objectif n'est pas seulement une amélioration à court terme dans une situation donnée. Les parents souhaitent une prise de conscience et un changement de comportement durable : les enfants doivent comprendre qu'ils ne doivent pas traîner et mettre leurs chaussures le matin avant le jardin d'enfants. Si on les récompense pour leur participation, on espère que cela sera mémorisé. Les enfants doivent comprendre qu'ils ne doivent pas hurler de colère et jeter des jouets. S'ils sont envoyés en «temps mort» pour se faire discipliner, ils se comporteront différemment la prochaine fois. Les adolescents doivent s'acquitter de leurs devoirs et moins surfer sur le net. Si on leur retire leur téléphone portable pendant une journée, ils feront tout pour ne pas être punis à nouveau de la sorte.
«Différentes études ont toutefois montré que les enfants ne comprennent souvent pas le sens des mesures prises et qu'ils perçoivent la situation de manière totalement différente», explique Nuša Sager. La formatrice en formation des parents et en compétences émotionnelles conseille de se demander d'abord si un enfant peut agir différemment dans une situation donnée, s'il est même déjà prêt dans son développement et s'il possède le contrôle de ses impulsions ou la régulation de ses émotions.
Lorsqu'un enfant est puni pour avoir enfreint une règle, il apprend surtout une chose, dit Nuša Sager : «Il ne doit pas se faire prendre la prochaine fois». Les enfants commencent alors à tricher, voire à mentir. «On génère un comportement asocial», explique la psychologue Nadine Zimet. L'Institut de recherche sur la famille de l'Université de Fribourg a fait des constatations similaires : l'étude sur le comportement punitif des parents en Suisse montre que les mesures n'ont pas conduit à un comportement social exemplaire, mais au contraire à un mauvais comportement à l'école, au mensonge, au vol et à l'agressivité.
Punir par impuissance
Poser des limites et transmettre des règles lorsqu'un enfant ne participe pas ? S'il ne réagit pas aux sollicitations amicales et fait obstinément son truc ? Comment montrer que l'on se réjouit de sa serviabilité lorsqu'un simple compliment est déjà considéré comme une récompense ? Les psychologues sont unanimes : les parents punissent ou appâtent leurs enfants parce qu'ils se sentent impuissants. Souvent, ils n'ont pas de modèle pour un style d'éducation qu'ils approuvent. Ils ne veulent pas vraiment appliquer les méthodes autoritaires des générations précédentes. Et ils n'ont tout simplement pas le temps d'essayer tout ce qui est possible.

Dans les moments de stress, les parents retombent dans leurs vieux schémas
«La réalité de la vie des parents comprend une liste de choses à faire qui s'allonge à l'infini, beaucoup de pression, de colère et d'épuisement», explique la psychologue Nadine Zimet. Cette surcharge a des conséquences : C'est justement dans les moments de stress que les parents s'entendent dire des phrases qu'ils connaissent depuis leur enfance et qu'ils rejettent en fait. D'où cela vient-il ?
La connaissance rationnelle des solutions est bloquée par de fortes émotions dans les moments de conflit. Les parents retombent alors rapidement dans de vieux schémas, même s'ils ne les aiment pas. Leurs expériences en tant que parents sont marquées par une sorte de double vécu : d'une part, ils ont été les «victimes» ou, en termes plus neutres, les «destinataires» des méthodes éducatives de leurs parents. Mais ils ont également appris à être des «bourreaux» ou des «éducateurs», car leurs parents étaient automatiquement leur modèle de comportement. «Lorsque nous dépassons les limites de nos enfants, nous leur montrons, en tant que parents, qu'il est acceptable de faire souffrir les autres», explique la psychologue Nuša Sager.
Quelles sont les valeurs et les comportements que je veux adopter et ceux que je ne veux pas adopter ?
Briser le système
La première étape pour briser ce système est de prendre conscience de ses propres empreintes et de réfléchir aux schémas difficiles. Comment était ma mère dans les situations de stress ? Comment était mon père lorsqu'il était en colère contre moi ? Il ne s'agit pas, dans ces réflexions, de mettre en doute sa propre enfance : il s'agit de faire le point. Quelles sont les valeurs et les comportements que l'on veut adopter et ceux que l'on ne veut pas adopter ? Nadine Zimet compare ce processus de développement d'alternatives aux traditions à l'apprentissage d'une nouvelle langue : on ne peut pas non plus la maîtriser du jour au lendemain, il faut de la pratique et du temps.
Que dois-je faire si mon enfant frappe un autre enfant dans la cour de récréation ? Puis-je le forcer à s'excuser ? La réponse d'Alfie Kohn serait que mon enfant n'éprouve pas de véritables remords. Au contraire, il ne fait semblant d'être désolé que pour moi. Il serait plus judicieux d'expliquer à mon enfant ce que ressent son vis-à-vis. Et de demander : que pourrais-tu faire pour que l'autre enfant se sente mieux ?

Impliquer les enfants dans l'élaboration des règles
Si l'enfant ne réagit pas et continue à se comporter de manière agressive, on peut effectivement le renvoyer à la maison. «L'enfant peut ressentir cela comme une punition, c'est pourquoi il faut lui expliquer cette étape», explique le professeur de psychologie Albert Düggeli. «On peut dire quelque chose comme : Tu sais, si tu fais du mal à d'autres enfants, je dois les protéger». Il est important qu'un enfant comprenne pourquoi ses parents imposent certaines règles.
Dans la mesure du possible, les enfants peuvent être associés à l'élaboration de certaines règles. L'utilisation d'Internet et du téléphone portable sont des exemples pour lesquels des accords communs et contraignants peuvent aider. «Si l'adolescent passe ses journées devant l'écran, il ne sert absolument à rien de lui retirer sa tablette ou son téléphone portable en guise de punition », explique Düggeli. «On n'est alors que le stupide voleur de téléphone portable, et dès que l'on tourne le dos à l'enfant, tout redevient comme avant».
Renoncer aux punitions et aux récompenses, ce n'est pas établir une cohabitation sans règles et sans direction parentale.
L'étape 1 consisterait à vérifier si le temps passé sur Internet est précieux pour l'enfant. Y échange-t-il des informations avec des amis ? Y fait-il preuve de créativité ? Comment se sent-il lui-même ? «La deuxième étape consisterait à créer une alternative à l'utilisation du téléphone portable. Trouve-t-on avec son enfant quelque chose qui lui procure autant de plaisir ?», explique Albert Düggeli.
Suivez-nous sur Pinterest !

Les enfants doivent connaître les limites de leurs parents
«Les enfants veulent être reconnus et confirmés», explique la psychothérapeute Nuša Sager. «Pour cela, ils n'ont toutefois pas besoin de récompenses matérielles, mais d'attention et de relation». Comment la situation se serait-elle déroulée à la piscine en plein air si le père était simplement entré dans le bassin avec ses enfants avant ? S'il avait dit : «Viens, ta sœur n'aime pas ça, nous allons jouer ensemble à autre chose».
Les parents qui souhaitent renoncer aux punitions et aux récompenses n'établissent pas pour autant une cohabitation sans règles et sans direction parentale. Cela implique également que les enfants apprennent à connaître les limites de leurs parents. Les adultes peuvent et doivent dire ce qui leur déplaît. L'attitude vis-à-vis de l'enfant est ici décisive. Est-ce que je m'attends à ce qu'il m'obéisse ? Ou est-ce que je le traite avec respect ? Le simple fait de réfléchir à cette différence change déjà beaucoup de choses dans les relations.
Les choses à ne pas faire : Essayez de renoncer aux récompenses sous forme de sucreries. L'université de Rochester a publié une étude qui a pu établir un lien entre le système de récompense et un comportement alimentaire perturbé : Les parents qui récompensent leurs enfants avec des sucreries leur apprennent à réguler leurs émotions par ce biais. Cela conduit à ce que l'on appelle l'alimentation émotionnelle.
Do : Exprimez votre appréciation. Votre enfant a rangé sa chambre ? Ou aide à mettre la table ? Exprimez votre joie. Remerciez votre enfant. «Merci d'avoir si bien participé».
Do : de manière générale, discutez des situations qui se sont bien déroulées. Les enfants et les adolescents n'ont pas seulement besoin d'un feedback critique en cas de difficultés. Les situations réussies doivent également être nommées.
Don't : Utilisez avec parcimonie les récompenses matérielles et les cadeaux en argent. Un regard sur l'économie, où les bonnes performances des collaborateurs sont souvent récompensées financièrement, suggère que les incitations matérielles poussent à être plus performant. Des études ont toutefois montré que cela ne s'applique pas à la motivation des enfants et des adolescents et que, par exemple, la participation scolaire ne s'en trouve pas durablement améliorée.
Do : l'attention plutôt que le paiement. Votre enfant n'aime pas lire et ne lit pas bien non plus ? Asseyez-vous régulièrement ensemble sur le canapé et plongez votre nez dans un livre. Si votre enfant est un lecteur débutant, faites-lui d'abord la lecture, puis prenez le relais de temps en temps.
Do : des actions communes pour fêter quelque chose. Votre enfant a beaucoup appris pour un travail ? Valorisez-le, indépendamment de la note obtenue. Offrez à votre enfant une activité commune qui lui tient à cœur, par exemple une excursion, une soirée cinéma ou un repas spécial.