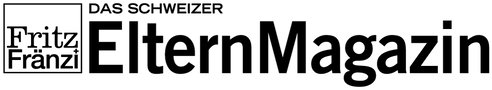Monsieur Wampfler, les médias numériques rendent-ils l'école meilleure ?
* Dans ce texte, nous utilisons le masculin, le féminin et les deux formes en alternance afin de respecter tous les genres. Cela vous plaît-il ? N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires à l'adresse redaktion@fritzundfraenzi.ch ou dans la zone de commentaires.
Monsieur Wampfler, vous avez probablement été l'un des premiers enseignants de Suisse à utiliser les médias numériques dans l'enseignement. Dès 2012, vous avez écrit un livre sur les médias sociaux à l'école. Quelle était votre motivation ?
Dans notre école, nous avons eu une formation très théorique sur les médias sociaux avec des experts externes. Au sein du corps enseignant, cela a eu tendance à accroître l'incertitude. Ce qui a été négligé, c'est la question de savoir comment les jeunes utilisent ces réseaux. Il existe un fossé entre les connaissances des élèves et celles des enseignants. Peu de temps après, je suis parti en vacances de formation continue, j'ai commencé un blog sur le sujet, j'ai assisté à des conférences et j'ai écrit le premier livre sur l'utilisation des médias sociaux dans les écoles. Depuis, je suis moi-même invité en tant qu'expert à des formations continues dans les écoles. Tout en disant aux écoles : «Vous ne pouvez pas déléguer durablement la responsabilité à des personnes externes». Les enseignants et la direction de l'école doivent se familiariser eux-mêmes avec les nouveaux médias.

Les médias numériques améliorent-ils fondamentalement l'enseignement ?
Il n'est pas possible d'enseigner sans utiliser de médias. Le tableau noir est également un média. Les médias numériques sont tout simplement des médias modernes. Un cours sans eux semble artificiel. J'ai encore souvent besoin du tableau noir - parfois je le numérise. Je regarde toujours ce qui est judicieux sur le plan didactique.
Pour quelles tâches les médias numériques doivent-ils en tout cas rester à l'écart ?
Par exemple, lorsque les élèves se réunissent pour résoudre un conflit. Dans ce cas, il serait problématique d'avoir des enregistrements numériques. Ou lorsque la motricité est importante :ce qui se passe lors de l'écriture à la main à l'école primaire ne peut pas être encouragé par les médias numériques.
«Si les élèves sont plus souverains que l'enseignant, le rapport de force se déplace».
Avez-vous rencontré des résistances de la part de vos collègues lorsque vous avez utilisé de nouveaux médias dans l'enseignement ?
En principe, les autres ne se souciaient pas de ce que je faisais dans la classe. Mais peu à peu, la direction de l'école s'est rendu compte qu'elle devait réagir à l'utilisation des médias par les enfants. On a d'abord essayé d'interdire les téléphones portables. Mais cela n'a pas pu être mis en œuvre. On a donc opté pour le «Bring your own device» : les appareils que les jeunes avaient de toute façon avec eux devaient être utilisés en classe. Cela a provoqué quelques réactions négatives.
Quels sont donc les préjugés ou les craintes qui se répandent au sein du corps enseignant ?
Certains professeurs de gymnase enseignent encore leur matière comme ils l'ont apprise à l'université. En sciences du langage notamment, cela signifie aller dans les bibliothèques, chercher des livres et les lire. Puis les élèves arrivent et disent : «Mais je trouve tout cela sur le net !». Cela peut conduire à une crise de sens pour l'enseignant. Dans un monde numérisé, son rôle change également. Il n'est plus la seule source de connaissances. De plus, avec les nouveaux médias, on s'aventure sur un terrain où les élèves sont plus souverains. Les rapports de force se modifient donc.
Mais il y a aussi des enseignants plus jeunes qui utilisent eux-mêmes les médias numériques depuis des années.
Oui, c'est l'une des raisons pour lesquelles la situation commence à se détendre. Toutefois, des études montrent également que les personnes qui se forment à la profession d'enseignant sont en général plutôt critiques vis-à-vis de l'utilisation des médias numériques à l'école.
Comment cela se fait-il ?
Elles ont elles-mêmes fait des expériences positives avec l'école analogique et deviennent enseignantes pour transmettre cela. Pas pour changer quelque chose.
«Nous devons sans cesse réfléchir et justifier ce que nous faisons avec les médias numériques. Et c'est bien ainsi».
Les parents ont-ils aussi des vents contraires ?
Les parents forment un groupe très hétérogène. Les uns disent : «Je me bats déjà contre cet appareil à la maison, pourquoi voulez-vous encore l'utiliser à l'école ?» D'autres travaillent eux-mêmes avec des médias numériques et trouvent l'école complètement dépassée.La plupart des parents, cependant, ne sont pas inquiets face à ce sujet. C'est très différent d'il y a cinq ou dix ans. Ils ont entre-temps acquis leur propre expérience avec les smartphones et les ordinateurs et se sont fait une idée des règles à respecter dans l'utilisation de ces appareils. Malgré tout, il y a bien sûr une pression de légitimation lorsque les écoles deviennent numériques. Et c'est une bonne chose.
Pourquoi ?
Parce que nous devons toujours réfléchir et justifier ce que nous faisons. Cela nous fait du bien, les enseignants ne sont pas des demi-dieux.
Comment les règles médiatiques de la maison influencent-elles l'enseignement ?
Les enfants issus d'un milieu éducatif élevé ont souvent des règles strictes et les enfants ne reçoivent généralement un smartphone que tardivement, par exemple lorsqu'ils entrent au collège. En revanche, pour les enfants issus d'un milieu peu instruit, le téléphone portable est souvent donné plus tôt et assorti de moins de règles, par exemple pour que l'enfant soit tranquille. Les enfants qui possèdent un portable très jeunes, à six ou sept ans, n'ont donc souvent pas appris les règles d'utilisation des médias. Les enseignants le voient alors et disent : «Alors, avec des enfants aussi jeunes, il ne faut pas utiliser les portables».
Comment voyez-vous les choses ? Devrait-il y avoir des contacts avec les médias numériques dès l'école primaire ?
Très clairement, oui. Pas pour remplacer la forêt et les expériences motrices, mais en plus. L'école primaire marque fortement notre conception de l'école et de l'acquisition des connaissances. Elle est - à l'exception de quelques projets phares - fortement marquée par l'analogique. Pourtant, dans le monde extérieur à l'école, les enfants apprennent souvent la langue et les images par voie numérique. Mes enfants ont appris à écrire sur les automates du tramway, où ils saisissaient des lettres.
Quelle quantité de numérique serait de trop ?
Il existe ce modèle américain, une véritable vision d'horreur : chaque élève est séparé derrière un PC et pour 100 élèves, il y a peut-être 3 enseignants, tout le reste est réglé par des programmes d'apprentissage spécialement adaptés à chaque élève. Et derrière eux se trouve une industrie puissante. L'aspect le plus important de l'école est l'aspect social. Il faut pouvoir y nouer des relations.
Vos élèves ont environ 15 ans et possèdent tous leur propre smartphone. Comment utilisez-vous concrètement les nouveaux médias en classe ?
Prenons l'exemple du cours d'allemand : je pourrais simplement écrire au tableau ce qu'est un «discours vécu». Ou je peux laisser les élèves le chercher eux-mêmes avec leur smartphone, créer un Google Doc et y rassembler différentes informations. Ils peuvent ensuite comparer : Qu'est-ce qu'une bonne source ? Ils constatent alors qu'il existe différentes définitions et qu'il n'y a donc pas de consensus. Cela ne dure pas éternellement, peut-être 10 à 15 minutes. Mais je suis convaincue qu'ils s'en souviennent mieux que si je me contentais de leur en parler.
Avez-vous un autre exemple ?
Tout ce qui concerne l'organisation passe par un chat WhatsApp. Les élèves peuvent me poser des questions sur leurs devoirs et je sais où ils en sont. Je peux m'en servir en classe.
Cela signifie qu'en tant qu'enseignant, vous devez être joignable 24 heures sur 24 ?
Non, il faut trouver une culture de la communication. J'ai des heures fixes où je suis en ligne sur WhatsApp et où je réponds aux questions. On développe aussi une compétence de filtrage et on voit à quels messages on doit répondre immédiatement.
Une compétence que les élèves devraient aussi acquérir...
Oui, bien sûr, nous en parlons en classe. Il y a des attentes différentes quant à la rapidité avec laquelle quelqu'un doit répondre. Cela peut devenir stressant. Avant les examens, certains de mes élèves ont développé la stratégie de mettre en sourdine le chat de la classe. Ainsi, ils ne peuvent pas se rendre fous les uns les autres.
Les téléphones portables doivent-ils rester éteints pendant leurs examens ?
Personnellement, je ne fais pas d'examens classiques. Je travaille en fonction des compétences. Par exemple, je viens de demander à des élèves d'écrire un commentaire sur un roman - dans Google Docs. D'autres élèves et moi-même leur donnons ensuite un feedback selon des règles strictes. Ensuite, les élèves peuvent finir d'écrire leur texte. Nous travaillons ensemble à l'amélioration d'un texte. Cela correspond aussi à la compréhension actuelle du texte : les textes numériques ne sont jamais simplement terminés. Je veux que les élèves apprennent à travailler de la même manière qu'ils en auront besoin plus tard dans le monde du travail.
Mais les élèves ne font-ils pas moins d'efforts avec un texte s'ils savent que ce n'est qu'une première version ?
Je ne dirais pas cela. Dans les dissertations, il y a toujours eu beaucoup de textes qui semblaient plutôt irréfléchis et qu'il aurait mieux valu retravailler. En revanche, la volonté d'améliorer un texte déjà terminé était plutôt encore plus faible.
«Si l'on montre un réel intérêt pour l'utilisation des médias par les jeunes, une relation de confiance mutuelle s'installe».
Certaines élèves sont-elles jalouses de leur propre succès sur les médias sociaux ?
Non, ce que je fais n'est pas particulièrement cool. Mes posts ont en effet un tout autre style que ceux des jeunes. Mais ils les respectent et les trouvent passionnants. Parfois, je les emmène avec moi lorsque je suis invité quelque part en tant qu'expert et j'essaie ainsi de les impliquer - car eux aussi sont des experts - pour LEUR communication.
En tant qu'enseignant passionné par les médias, est-on automatiquement une personne de confiance pour les élèves ?
C'est une confiance mutuelle qui s'installe parce que je m'intéresse vraiment à la manière dont ils utilisent les nouveaux médias. Je leur pose des questions, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, et c'est comme ça qu'on arrive à dialoguer.
Les élèves apprennent-ils aussi de vos erreurs dans l'utilisation des médias ?
Ils me demandent parfois, lorsqu'il y a des discussions enflammées sur mes profils : «Qu'est-ce qui vous stresse maintenant ? Nous regardons alors cela ensemble et je leur demande : "Comment réagiriez-vous maintenant ?» Mais il est vraiment souvent difficile de comparer, parce que les jeunes sont par exemple beaucoup plus réticents à la critique publique.
«Entre filles, le simple fait de ne pas aimer une image Instagram est considéré comme un acte d'agression».
Cela me surprend.
Oui, parmi les filles, le fait de ne pas aimer une photo Instagram est déjà considéré comme un acte d'agression. Ils trouvent gênant que nous, les enseignants, menions ensuite une discussion dans les commentaires de la chaîne YouTube de la classe. C'est un drame public, on ne devrait pas le montrer à tout le monde.
Est-ce qu'on écrit encore sur papier chez vous ?
Oui, prendre des notes pendant le cours fonctionne mieux sur papier. De nombreuses études le prouvent.
Comment jugez-vous le module Médias et informatique du programme scolaire 21 ?
Je trouve réussi que les compétences d'application, les compétences de réflexion et l'informatique soient abordées. Le module crée une obligation et est un pas dans la bonne direction. Mais ce n'est pas une révolution. L'espace occupé par les nouveaux médias est trop petit et la compétence médiatique n'est pas assez liée à d'autres compétences. Je crains que certains enseignants pensent qu'ils ne doivent plus rien faire avec les nouveaux médias.
Quel est le niveau de compétence médiatique des jeunes ?
Tout dépend de la perspective. Les adultes ne comprennent souvent pas du tout à quel point l'utilisation des médias, avec toutes ses règles de communication, est complexe chez les jeunes. Tout ce qu'il faut savoir et connaître. Cette compétence n'est pas appréciée à sa juste valeur par les adultes. Dans un autre domaine, je pense qu'il faut agir : de nombreux jeunes ont du mal à filtrer les informations pertinentes et vraies. C'est là que l'école doit intervenir pour préparer les jeunes à la vie. Lorsque l'on tape une question sur Google, on trouve toujours la réponse que l'on souhaite entendre. Les jeunes devraient réapprendre à se constituer un réseau de connaissances et à demander à des spécialistes lorsqu'ils ne sont pas sûrs d'eux. Cela n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui, grâce à Internet.
La révolution numérique dans les salles de classe. Notre grand dossier d'octobre 2017
Quel est le degré de numérisation des écoles suisses ? Que pensent les enfants et les parents de l'enseignement avec les tablettes et autres ? Comment les enseignants font-ils face à ces bouleversements ? Et comment protéger les données des élèves quand tout devient numérique ?
Tout cela dans notre grand dossier du numéro d'octobre. Commandez-le ici.
Lire la suite : Quelle est la part des médias dans le programme d'enseignement 21 ?