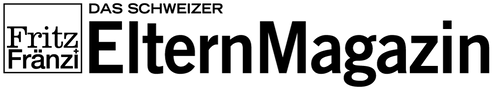Monsieur Schredl, pourquoi les enfants font-ils des cauchemars ?
Monsieur Schredl, qu'est-ce qu'un rêve pour vous ?
Pour moi, le rêve est l'expérience subjective vécue pendant le sommeil. La caractéristique spécifique est que, dans le rêve, on pense être éveillé. Le temps nécessaire pour vivre des expériences en rêve est comparable au temps nécessaire pour vivre des expériences éveillées. Nous n'agissons donc pas plus vite dans les rêves qu'à l'état de veille. En revanche, des sauts sont possibles. Si je rêve par exemple de gravir une montagne, je peux tout simplement interrompre la randonnée à ma guise et me retrouver soudainement à la plage dans les Caraïbes. En état de veille, notre cerveau produit en permanence des sensations, des pensées, des représentations et des souvenirs. Pour ce faire, il active des réseaux neuronaux qui sont également activés pendant le sommeil. Le cerveau fait appel aux expériences que l'on a faites dans la vie éveillée et mélange le tout de manière très créative.

Si le rêve est basé sur des expériences de la vie éveillée, comment se fait-il que l'on fasse des rêves irréalistes, comme par exemple celui de pouvoir voler ?
Dans ce cas, nous parlons de discontinuité : nous pouvons rêver de quelque chose que nous n'avons jamais vécu dans notre vie éveillée. Les rêves sont riches en imagination, tout comme nos pensées à l'état de veille : nous sommes capables d'inventer des histoires et d'imaginer que nous volons. Mais en rêve, cela semble plus réel et souvent plus beau. Les expériences vécues à l'état de veille jouent néanmoins un rôle, comme nous le savons par la description des rêves de vol : La plupart du temps, les expériences décrites sont celles que nous connaissons, par exemple la natation. Moi-même, lorsque je vole, je fais une sorte de plongeon.
Les enfants rêvent-ils différemment des adultes ?
Comme nous pensons typiquement être éveillés pendant le rêve, un rêve pourrait être rappelé comme un événement réel après le réveil. Cela se produit souvent chez les jeunes enfants. Ils ne reconnaissent pas encore les images de rêve comme des représentations imaginaires produites dans leur tête. En revanche, la plupart des enfants de cinq ans peuvent classer les rêves comme des expériences subjectives pendant le sommeil. Certains rêves peuvent toutefois prêter à confusion, même chez les adultes : si l'on rêve de l'environnement réel - par exemple se réveiller dans son propre lit - il peut être difficile de faire la différence entre le rêve et l'expérience réelle au réveil.
Y a-t-il aussi des différences au niveau du contenu ?
Comme la vie éveillée des enfants et des adultes est différente, leurs rêves le sont également. Les jeunes enfants rêvent plus d'animaux, les adolescents plus de leurs pairs et d'interactions avec eux ; des thèmes qui sont importants à ces stades de la vie. Les rêves des jeunes enfants ne sont pas aussi détaillés que ceux des adultes. Cela est probablement lié à leur capacité d'expression : ils décrivent également de manière moins détaillée les expériences vécues à l'état de veille. Nous constatons également des différences entre les sexes. Les garçons rêvent davantage d'agression physique. Chez les filles, les rêves se déroulent davantage dans des espaces fermés. Probablement parce que les garçons se battent davantage à l'extérieur, tandis que les filles ont plus d'activités à l'intérieur.
De nombreux enfants font état de cauchemars. Les cauchemars sont-ils pathologiques ?
Au départ, un cauchemar n'est pas pathologique. Il est défini comme un rêve avec un affect fortement négatif, qui conduit généralement au réveil. Parmi les cinq thèmes les plus fréquents, on trouve les rêves dans lesquels on tombe, on est poursuivi, on est paralysé, des proches meurent ou on est en retard. De tels rêves sont pathologiques lorsque leur fréquence affecte l'humeur et la capacité de concentration et favorise la peur de s'endormir. La règle générale est d'avoir au moins un cauchemar par semaine. Chez les enfants, la caractéristique la plus visible est la peur de s'endormir ou de faire à nouveau un mauvais rêve.
Pourquoi les enfants font-ils plus de cauchemars ?
Si, au cours de leur développement, les enfants apprennent à gérer de manière constructive les peurs de la vie éveillée, les cauchemars - les peurs de la nuit - diminuent également. Cependant, chez les personnes qui font souvent des cauchemars, la fréquence reste relativement constante au cours de la vie, car la prédisposition joue ici un rôle.
Quelles sont les causes les plus fréquentes des cauchemars ?
Nous partons de ce que l'on appelle le modèle de stress prédisposant : Celui-ci stipule qu'il existe un facteur génétique lié à la personnalité. Des chercheurs américains ont décrit les cauchemars comme des personnes aux «frontières minces» (thin boundaries). Ils sont souvent sensibles, imaginatifs et créatifs. Outre cette prédisposition, le stress joue un rôle important. C'est ce qui est apparu dans notre recherche auprès d'étudiants : Plus une personne est stressée, plus elle fait de cauchemars.
Que peuvent faire les parents si leur enfant a peur de s'endormir ?
Les parents peuvent s'entraîner avec leur enfant à gérer ses peurs de manière constructive. Dans un premier temps, l'enfant doit dessiner la scène de rêve la plus importante, de sorte que le cauchemar passe de la tête au papier. Dans un deuxième temps, il réfléchit : qu'est-ce qui pourrait m'aider à avoir moins peur ? Il ajoute l'élément correspondant - par exemple les parents ou un magicien - dans le dessin. L'enfant apprend ainsi : la peur n'est pas grave, je peux inventer l'aide dont j'ai besoin. Le dessin est revu ensemble cinq à dix minutes par jour pendant deux semaines - de préférence pendant la journée, lorsque l'enfant est en pleine possession de son imagination. La nuit, il est préférable de réconforter et de rassurer l'enfant pour qu'il puisse se rendormir.
A propos de la personne
Lire la suite :
- Que signifient les rêves et comment naissent-ils ? notre grand texte-dossier
- La zone de combat du lit parental: comment les parents doivent-ils gérer le fait que leur fille de 5 ans ne fasse toujours pas ses nuits ?
- Dors, petit enfant, dors ! Au fur et à mesure que l'enfant grandit, les cernes des parents s'estompent. Mais un saut dans le développement survient et tout recommence.