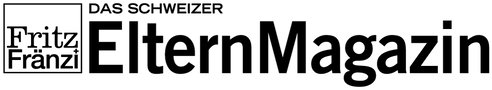Monsieur Fritz-Schubert, comment les enfants trouvent-ils leurs points forts ?
L'appartement d'Ernst Fritz-Schubert et son institut à but non lucratif pour le renforcement de la personnalité et du bien-être se trouvent dans une maison plus que centenaire au Philosophenweg à Heidelberg. L'interview a lieu dans le salon. Une pièce confortable avec de vieux meubles anciens et une vue magnifique sur le jardin romantique. Quand Ernst Fritz-Schubert parle et explique, il le fait avec engagement et les yeux brillants.
Vous dites que les enfants qui peuvent prendre soin de leur bien-être sont mieux protégés contre les problèmes psychiques.
Oui - et il s'agit ici d'un bien-être à long terme, donc de satisfaction. Trois thèmes sont essentiels à cet égard : Comment puis-je avoir de bons sentiments ? Comment développer l'engagement ? Et comment puis-je avoir des relations épanouissantes ? Il est particulièrement important de croire en soi, en sa propre singularité et en ses points forts. Pour les reconnaître, nous avons besoin de personnes autour de nous qui nous donnent un feedback positif, nous reflètent et nous valorisent.
Et qu'en est-il des enfants qui ne savent pas quels sont leurs points forts et qui sont peu informés de leurs besoins ?
Ce sont souvent les enfants qui doivent s'adapter et suivre le courant. Ou alors, ils peuvent avoir un comportement agressif pour se sentir soi-disant forts, ou devenir dépressifs. Et comme ils ne connaissent pas leurs points forts, ils ne peuvent pas vraiment se supporter eux-mêmes. De nombreux enfants connaissent davantage leurs faiblesses que leurs forces. Partout, on recherche les erreurs et les pannes - et non nos trésors ! Or, nous devons connaître nos trésors, les utiliser et apprendre à les gérer. Si je suis bon à quelque chose, je me sens bien avec.
«Pour pouvoir aussi se souffrir soi-même, il faut connaître ses points forts».
La question la plus importante est donc : qui suis-je ? Comment le savoir ?
Ernst Fritz-Schubert se lève de son fauteuil et va chercher une balle et un gros fil rouge dans son bureau. Il lance la balle à la journaliste en lui disant : "Dans vos mains, elle va devenir une boule de force ! Alors, dites spontanément ce que vous savez faire et renvoyez-moi la balle ! Ernst Fritz-Schubert et la journaliste commencent à se lancer la balle l'un à l'autre en citant à tour de rôle leurs points forts. Il remet ensuite le fil rouge dans les mains de la journaliste en lui demandant : "Imaginez trois événements qui ont été importants pour vous dans votre vie jusqu'à présent ! Pour l'un d'entre eux, réfléchissez aux forces dont vous disposez et à la manière dont vous avez pu le surmonter ! La journaliste se prête à l'exercice et parle d'elle-même et d'un événement qui a été particulièrement important pour elle. Ernst Fritz-Schubert résume alors la situation : Vous avez activé, à l'aide de vos souvenirs, des forces et des atouts qui sont en vous - et dont vous pouvez aussi avoir besoin pour beaucoup d'autres choses. Ces brefs exercices montrent comment les enfants aussi découvrent quels sont leurs points forts, ce qui leur appartient et ce qui les caractérise. Car lorsque je sais qui je suis et quelles sont mes possibilités, je trouve ma place dans ce monde. C'est un sentiment très gratifiant.
Quelle force possédez-vous depuis votre enfance ?
Je fais du vélo de course depuis mon adolescence. Aujourd'hui, j'ai 67 ans et je continue à le faire - et j'éprouve un plaisir incroyable à dévaler les pentes ou à rivaliser avec d'autres qui sont peut-être plus jeunes que moi. Dès mon adolescence, je me sentais très bien lorsque je m'entraînais sur mon vélo de course. Et cela m'a permis d'acquérir des forces telles que la persévérance et l'endurance, qui me sont également utiles dans d'autres domaines. Donc, si nous savons comment activer nos points forts, nous nous en sortons bien. Malheureusement, cela n'arrive pas assez souvent à l'école, l'endroit où les enfants passent d'innombrables heures de leur vie.
Que voulez-vous dire ?
Jusqu'au moment où ils entrent à l'école, de nombreux enfants apprennent avec une extrême motivation, tombent et se relèvent des centaines de fois pour s'entraîner à marcher, par exemple. Mais ensuite, ils entrent à l'école, et cet apprentissage intrinsèquement motivé est de plus en plus en berne. Pour de nombreux enfants, le meilleur moment de l'école reste les pauses et les vacances. On dit que l'enseignant lance une piste artificielle et que les élèves font semblant de la suivre. A l'école, les enfants sont déterminés par des tiers, ils sont notés, ils sont véritablement fonctionnalisés. Ils ne créent pas eux-mêmes, la foi en leurs propres capacités n'est pas développée. Réussir à l'école signifie faire attention, prendre des notes, reproduire, ne pas contredire trop souvent l'enseignant - en d'autres termes, devenir plus ou moins girouette.

Comment l'apprentissage serait-il plus utile selon vous ?
Les enfants et les jeunes apprendraient mieux en enseignant eux-mêmes, c'est-à-dire en transmettant ce qu'ils ont appris à d'autres. Et si je peux en outre utiliser ce que j'ai appris, cela me motive également. L'apprentissage d'une langue étrangère pourrait par exemple se faire avec d'autres jeunes qui parlent cette langue. L'apprentissage doit être lié à la vie quotidienne, à la pratique. Et surtout, c'est aussi la tâche de l'enseignant de découvrir avec les enfants ce qu'ils savent bien faire. La relation avec l'enseignant est ici d'une importance capitale. Si l'enseignant dit par exemple : les mathématiques sont importantes, vous pouvez me faire confiance - et s'il rayonne et vit vraiment cette conviction, alors les élèves s'identifient à lui et aux contenus qu'il leur transmet, et l'apprentissage peut fonctionner. L'enseignant doit bien sûr aussi expliquer aux enfants à quoi servent les mathématiques. Il transmet son enthousiasme aux élèves, et c'est ainsi que se produisent l'écho et la résonance. Mais cela suppose que l'enseignant s'engage dans ce processus de développement avec ses élèves.
«L'apprentissage peut rendre heureux lorsque les enseignants s'engagent vraiment avec les enfants».
Comment y parvient-il ?
En pratiquant lui aussi l'auto-formation et en connaissant ses points forts. Et il faut une base relationnelle entre l'enseignant et l'élève, basée sur l'honnêteté et la franchise. C'est ainsi que l'enseignant peut se montrer authentique, peut-être en se présentant devant la classe le matin et en disant qu'il ne se sent pas très bien aujourd'hui parce qu'il a pris une amende à l'aller. Il peut le faire parce qu'il n'a pas besoin de cacher ce qu'il ressent devant les élèves. Et puis, il invite peut-être les enfants à proposer des idées pour que le cours se déroule quand même bien, dans le sens de : Faites preuve d'imagination pour me remonter le moral... !
Toutes les choses fondamentales dont vous parlez doivent être enseignées aux enfants dans la matière scolaire «bonheur» que vous avez initiée. Comment cela se passe-t-il ?
Les enfants apprennent qui ils sont, ce qu'ils peuvent faire et ce dont ils ont besoin pour mettre en œuvre leurs points forts. Ce processus de développement de la personnalité se déroule en six étapes. Tout d'abord, les élèves apprennent à connaître leurs points forts. Ensuite, nous nous penchons sur les rêves des enfants. Et ils apprennent à décider, à planifier et à mettre en œuvre. Et la réflexion - l'approfondissement de la réflexion - est toujours très importante. Celui qui sait le faire en tirera profit pour beaucoup d'autres choses dans la vie.
La matière scolaire «bonheur» est proposée sous forme d'unité d'enseignement séparée ?
Si un enseignant souhaite également intégrer ces contenus fondamentaux dans les cours de mathématiques ou de langues, c'est encore mieux ! Si l'enseignant dit à ses élèves : "Nous voulons maintenant atteindre ensemble un certain objectif d'apprentissage, et nous réfléchissons maintenant aux points forts de chacun d'entre nous, à la manière de les gérer et d'atteindre ainsi notre but. Il peut alors se poser les questions suivantes avec les élèves : Comment remarquons-nous que nous progressons ? Comment apprenons-nous à nous concentrer, à nous motiver ? Et si l'on atteint des limites : comment les surmonter ? Quelles ressources pouvons-nous activer ?

Cela semble exigeant...
Cela nécessite avant tout une ouverture d'esprit pour s'engager dans ce processus d'apprentissage axé sur la relation. Je vais vous donner un exemple : Je suis conseiller en psychologie du sport pour la promotion des jeunes d'un club de football de la Bundesliga. Nous avons eu un jour un entretien intensif avec un joueur d'une équipe - un attaquant - et on peut dire que ce jeune, de par sa position, était plutôt égocentrique. Il s'est avéré que ce jeune homme avait besoin d'être mieux accueilli dans l'équipe, donc de devenir plus social. Les autres membres de l'équipe étaient d'abord sceptiques : leur collègue allait-il vraiment réussir à s'impliquer davantage dans le groupe ? Nous avons commencé à travailler sur ses points forts, qui pourraient être utiles pour atteindre cet objectif. C'est ainsi que nous avons découvert son sens de l'humour. Le jeune attaquant avait la capacité de rire de lui-même, ce qui le rendait sympathique. En se concentrant davantage sur ce point fort, à savoir l'autodérision, il a non seulement appris à mieux se connaître, mais a également fait l'expérience de la manière dont il pouvait utiliser ses points forts.
La mise en œuvre a-t-elle donc fonctionné ?
Oui, quatre semaines plus tard, l'enthousiasme pour le changement était palpable dans toute l'équipe. L'attaquant qui était auparavant plutôt égocentrique était devenu beaucoup plus social ! De tels progrès ne peuvent se produire que s'il y a une ouverture d'esprit et qu'il est possible d'exprimer ses propres besoins, sans avoir honte de les exprimer.
Les enfants et les adolescents, voire des classes entières, qui ont bénéficié de l'enseignement du «bonheur» changent-ils ?
Les déclarations concernant l'auto-évaluation des élèves qui ont suivi la matière scolaire «bonheur» sont par exemple les suivantes : «Je sais maintenant plus précisément ce que je veux et ce que je ne veux pas». Ou encore : «Je n'aurais jamais pensé que nous avions autant de camarades de classe sympas dans notre classe». En outre, les enseignants font état d'élèves plus sûrs d'eux et plus engagés. Les évaluations réalisées confirment ces impressions. On a pu constater empiriquement une augmentation du sentiment d'efficacité personnelle, de la confiance en soi et une estime de soi accrue et plus stable. Ce sont toutes des conditions importantes pour la santé mentale et des personnalités fortes.
La connaissance de soi rend heureux ?
Oui, mais la connaissance seule ne suffit pas, il faut ensuite vivre, mettre en œuvre et pratiquer les connaissances acquises. Cela implique d'être attentif à soi-même et aux autres.
Êtes-vous heureux ?
Pour moi, le bonheur n'est pas un état final, mais plutôt un processus. Être heureux en permanence serait ennuyeux à la longue. Je suis heureux de pouvoir profiter de la vie avec des personnes que j'aime. Et je suis prête à relever des défis qui me feront grandir.
Sur la personne :
Ernst Fritz-Schubert est juriste de formation, économiste et ancien directeur d'école. En 2007, il a introduit avec des experts la matière scolaire du bonheur en Allemagne, qui est enseignée en Suisse en tant que projet pilote au Theresianum Ingenbohl SZ. Il est marié et père de deux enfants adultes.
L'Institut Fritz-Schubert
En 2009, Ernst Fritz-Schubert a fondé l'institut de développement personnel du même nom, qu'il dirige depuis lors à titre bénévole. Son objectif est de renforcer l'auto-formation et le bien-être durable des personnes. Les dernières découvertes en matière de recherche sur l'apprentissage sont ainsi associées à des expériences pédagogiques éprouvées. www.fritz-schubert-institut.de
Suggestions de livres :
- Ernst Fritz-Schubert : Le bonheur s'apprend. Ce qui rend les enfants forts pour la vie. Ullstein, livre de poche. Fr. 12.90
- Ernst Fritz-Schubert, Wolf-Thorsten Saalfrank, Malte Leyhausen : Livre pratique sur le bonheur à l'école. Bases et méthodes. Beltz. Fr. 39.90 (à paraître le 14 septembre)