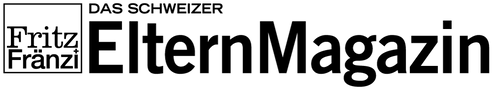Madame Leibovici-Mühlberger, pourquoi doutez-vous autant de notre jeunesse ?
Madame Leibovici-Mühlberger, vous dites que les jeunes sont mal équipés pour affronter l'avenir. Quelles sont les lacunes ?
Nous sommes confrontés à de grands défis sociaux. Nos enfants devront un jour assumer encore plus de responsabilités décisionnelles que nous aujourd'hui. Cela exige des personnalités intégrées et stables. Or, de plus en plus de jeunes préfèrent chiller plutôt que d'être performants, sont égocentriques, pleurnichards et pleins de résistance.
Ce n'est pas une bonne note que vous donnez à la jeunesse.
Eh bien, je rencontre aussi beaucoup de jeunes qui m'impressionnent. Ils agissent de manière sociale et responsable, ils sont réfléchis et prévoyants. Je ne dis pas que les jeunes dont il est question dans mon livre représentent la majorité de leur groupe d'âge.
Alors, ça ne doit pas être si terrible.
Il suffit que quelques-uns s'agitent pour faire chavirer un bateau. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire des ricochets. Ce que j'apprends dans ma pratique et dans mes échanges avec des collègues professionnels me laisse toutefois penser que le nombre de jeunes dits «délinquants comportementaux» augmente. Je peux comprendre leur résistance. Ils sont tombés dans le piège d'un mensonge éducatif et cela les blesse.

Un mensonge sur l'éducation ?
Oui. De nombreux parents n'assument pas leur mission éducative. Ils ne veulent pas guider leurs enfants, mais se considèrent comme leurs étriers. Ils ont cet idéal narcissique de liberté qui semble infantile, où l'individualité et le libre épanouissement sont la maxime suprême. La priorité pour les parents est de ne pas éduquer un sujet, mais un esprit libre.
Qu'y a-t-il de mal à cela ?
Les parents font comprendre à leur progéniture qu'elle a toujours le choix. Ils considèrent que leur propre mission est d'encourager les enfants par des activités et de les doter de biens de consommation. Ils considèrent volontiers le spleen ou le mauvais comportement de leurs enfants comme un signe de leur individualité. Ce faisant, ils oublient généreusement la véritable problématique : l'enfant a perdu ses repères parce que personne ne lui a montré les limites. Plus tard, il en paiera le prix.
De quelle manière ?
A l'adolescence, il éclate dans une réalité que ses parents ne peuvent plus contrôler. L'enfant n'est pas préparé à la société de l'augmentation, dans laquelle ce n'est pas le libre épanouissement qui compte, mais la performance. Il comprend qu'il est parti dans la mauvaise direction parce que quelqu'un a mal placé les panneaux. C'est pourquoi je dis : ne mentez pas à vos enfants !
De quoi ces jeunes manquent-ils ?
Ils disposent de peu de contrôle de soi et d'empathie, une approche structurée leur est souvent impossible. Ils n'ont pas appris à différer leurs besoins et n'ont pas les compétences nécessaires à la survie économique. Et en plus, leurs alliés les plus proches se retournent contre eux.
Les jeunes entendent pendant des années qu'ils sont uniques et soudain, on leur pose des exigences.
Martina Leibovici-Mühlberger
Les parents ?
Je soigne de nombreux jeunes qui ont entendu pendant des années à quel point ils étaient uniques, jusqu'à ce que leurs parents leur présentent la facture : regarde ce que nous avons fait pour toi ! Les efforts ne doivent pas être vains. Soudain, les parents posent des exigences, ce à quoi les jeunes ne sont pas habitués. Ils répondent par le refus. Et ils ne sont pas prêts à assumer une responsabilité sociale.
Et c'est la faute de ses parents.
Les parents ne font que s'orienter vers ce que la société nous présente comme la voie royale : Fais le maximum de ta vie, réalise-toi ! Cet idéal narcissique est chatoyant, mais plein d'ambiguïtés. L'enfant doit se réaliser comme il l'entend, mais doit en même temps servir de baromètre pour mesurer la réussite de ses parents. La liberté des uns ne s'arrête plus là où celle des autres est réduite. On a érigé l'ego-entreprise en maxime du bonheur. Les mères et les pères ont la vie dure de nos jours.
Peuvent-ils encore faire quelque chose ?
Nous pouvons renverser la vapeur en assumant la responsabilité de nos enfants et en cessant de les éduquer dans le sens du confort. Car les enfants ont besoin d'un esprit éveillé dans une société qui les considère avant tout comme des consommateurs et les courtise. Si nous considérons que l'enfance mérite d'être protégée, nous devons utiliser l'avance que nous avons sur nos enfants en termes d'expérience. Sinon, nous leur faisons du tort. Il n'est donc pas étonnant que de nombreux jeunes se détournent de leurs parents sur le plan émotionnel.
Des études indiquent plutôt le contraire, elles décèlent une forte proximité.
Ce qui est déterminant, c'est la manière dont nous définissons cette proximité : S'agit-il du niveau des ressources ou de la relation ? On a tendance à mélanger les deux. La proximité signifie-t-elle que l'on reste chez soi de manière pratique ou s'agit-il d'une proximité émotionnelle ? De nombreux jeunes décrivent la relation avec les parents comme bonne, tant que ceux-ci les laissent tranquilles. Ce qui m'intéresse, c'est la culture de la relation : est-ce qu'on entretient des échanges, des rituels ? Cela permet de se faire une idée plus nuancée.
Les critiques vous reprochent de tirer des conclusions générales à partir de cas extrêmes.
Dans mes déclarations, je ne me réfère pas seulement à mon travail de psychothérapeute, je forme également des enseignants. Les réactions de ces derniers ne sont pas moins bouleversantes. Lorsque, comme récemment, une directrice d'école secondaire à Vienne me dit que 20 pour cent des jeunes qui quittent l'école ne trouveront pas d'emploi parce qu'ils manquent de contrôle de leurs impulsions, qu'ils se vexent facilement et qu'ils ne sont pas habitués à s'organiser, c'est alarmant.
Lire la suite :
Ce texte a été publié dans le cadre de notre dossier sur la jeunesse 2016.
- Realistisch, pragmatisch, angepasst - so tickt die Jugend von heute.
- Was uns wirklich wichtig ist... Jetzt spricht die Jugend selbst.