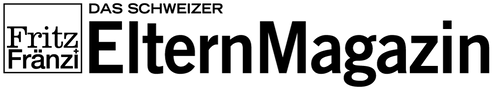La gifle dans l'éducation est encore trop normale en Suisse
Monsieur Baier, vous effectuez depuis des années des recherches en Allemagne sur le thème de la violence dans la famille, et vous avez maintenant réalisé une étude à grande échelle en Suisse. Qu'est-ce qui vous a surpris ?
D'une part, la violence est toujours considérée ici comme un élément normal de l'éducation. Seul un jeune sur trois a déclaré n'avoir subi aucune forme de violence dans sa famille lorsqu'il était enfant. En Allemagne, deux jeunes sur trois ont déclaré la même chose dans une étude comparable. Deuxième constatation surprenante : les différences entre les jeunes issus de l'immigration et les autres sont énormes : certains groupes présentent un taux de violence intrafamiliale quatre à cinq fois plus élevé.
Comment expliquez-vous la grande différence avec notre pays voisin ?
Tout d'abord : nous avons également étudié les formes positives d'éducation, le degré d'attention par exemple, c'est-à-dire la disposition des parents à réconforter. Dans ce domaine, la Suisse est aussi bien placée que l'Allemagne. Mais il s'est avéré que dans la culture éducative suisse, on a plus souvent recours à des formes légères de violence comme les gifles. Mais il faut noter qu'en Allemagne aussi, il y a beaucoup de familles qui se battent. Et qu'en Suisse, il y a beaucoup de familles qui n'ont pas recours à la violence. Nous n'avons pas encore de réponse définitive. Le fait qu'en Allemagne - contrairement à la Suisse - le châtiment parental soit interdit depuis l'an 2000 peut jouer un rôle.

La phrase «Une gifle n'a jamais fait de mal à personne» est toujours valable en Suisse ?
Oui, bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord, mais une grande partie de la population l'est toujours.
Pourquoi cette phrase est-elle fausse ?
Une gifle ne passe pas inaperçue chez un enfant. Une relation de confiance est ainsi détruite : la confiance dans les parents, mais aussi dans le monde en tant que lieu sûr.
Rien qu'en le giflant ?
Il y a bien sûr une différence entre le fait qu'un enfant soit régulièrement battu et celui qu'il le soit rarement, et entre les châtiments corporels et la violence grave. Si l'enfant a subi des violences graves, il est par exemple plus probable qu'il devienne lui-même violent par la suite. Mais nous constatons également des différences significatives entre les groupes de comparaison «pas de violence subie» et «châtiments corporels subis» - justement la fameuse gifle. La recherche montre clairement que toute forme de violence physique fait des dégâts.
La gifle est-elle la forme d'exercice de la violence la plus répandue dans l'éducation en Suisse ?
Oui, la plupart des jeunes ont déclaré avoir reçu des gifles. Un nombre relativement important d'entre eux ont déclaré avoir été «saisis durement» ou «poussés». Les violences les plus rares sont les violences graves, comme le fait d'être frappé ou de recevoir des coups avec des objets.
Vous avez également mentionné les différences liées à l'origine. Il s'agit d'une catégorie politiquement controversée - pourquoi l'avez-vous incluse dans l'étude ?
La diversité culturelle est quelque chose qui définit la société moderne. Et je pense que les connaissances dans ce domaine peuvent aider à aborder les problèmes.

Quelles sont les conclusions que vous avez tirées ?
La violence grave dans le cadre de l'éducation est nettement plus fréquente chez les jeunes originaires d'Asie du Sud-Est, d'Europe du Sud-Est et d'Afrique. Je l'explique essentiellement par des conceptions différentes de ce que doit être l'éducation. Il s'agit de cultures dans lesquelles les structures familiales patriarcales sont encore plus fréquentes.
Qu'est-ce que cela signifie ?
L'homme est le chef de famille qui s'impose aussi par la violence. Non pas parce qu'il prend plaisir à frapper, mais parce qu'il lui manque des possibilités de sanctions alternatives pour montrer à l'enfant que quelque chose n'allait pas. Ces idées existent depuis des siècles. Et elles sont fausses : on ne peut pas donner des coups de poing pour faire preuve de discernement.
Sur la base de votre étude, on pourrait avoir l'impression que la violence au sein de la famille en Suisse est aujourd'hui un problème d'étrangers.
Ce serait une erreur à double titre. Premièrement, nous constatons qu'une famille autochtone non immigrée sur dix continue de recourir à la violence grave dans l'éducation. Deuxièmement, comme nous l'avons mentionné, les châtiments corporels font également partie de la culture éducative d'une majorité de familles autochtones. Dans l'ensemble, les taux de violence intrafamiliale sont plus faibles - mais encore beaucoup trop élevés - dans la population non issue de l'immigration.
Plus une famille est religieuse, plus la probabilité de violence dans l'éducation est élevée - cela vaut indépendamment de la religion.
Selon leur étude, les familles de migrants en Suisse recourent nettement plus souvent à la violence que les familles de migrants en Allemagne. Pourquoi ?
En Allemagne, il y a toujours eu des initiatives visant à diffuser la connaissance selon laquelle la fessée est nocive et ne doit pas faire partie de l'éducation. On a aussi délibérément tenté d'introduire ce savoir dans les communautés d'immigrés : Il y a eu des dépliants en turc, des articles dans l'édition allemande du journal turc Hürriyet. En Suisse, il y a un retard à rattraper dans ce domaine. Je me souviens de l'intervention d'un homme d'origine turque après une conférence que j'ai donnée sur le sujet. Il a dit qu'après avoir immigré en Suisse, il lui avait fallu du temps avant d'entendre pour la première fois que les coups étaient mal vus ici.
Comment peut-on maintenant utiliser ces connaissances pour aborder le problème ?
Cela peut paraître banal, mais une première approche consiste à sensibiliser les personnes qui sont en contact quotidien avec les enfants et les jeunes, c'est-à-dire les enseignants et les éducateurs. Je ne mettrais pas l'accent sur certains pays d'origine, mais plutôt sur des régions plus vastes : Asie, Europe de l'Est, Afrique. Les enfants et les jeunes issus de familles de cette origine sont plus exposés au risque de violence. Et cela peut les amener à avoir un comportement particulier à l'école ou à avoir de moins bons résultats scolaires.
Voyez-vous d'autres approches ?
Un deuxième point est que l'on s'interroge de plus en plus sur le contexte : les parents sont-ils exposés à un stress élevé ? Ont-ils vécu des événements traumatisants dans leur enfance, lors de leur fuite ? Serait-il utile de proposer un soutien psychologique aux parents ?
Ils ont trouvé dans l'étude une autre corrélation intéressante : Plus une famille est religieuse, plus la violence grave est fréquente. Comment expliquez-vous cela ?
Ce lien se manifeste indépendamment de l'appartenance religieuse et de l'origine migratoire. Pour moi, cela a un rapport avec le conservatisme : Plus la religiosité est forte, plus il existe une vision conservatrice du monde en ce qui concerne la relation entre parents et enfants. C'est ce qui est fou dans cette affaire : le mal, c'est-à-dire la violence, est utilisé pour faire le bien. Les parents veulent ainsi amener les enfants sur le bon chemin. On retrouve généralement ce lien dans les milieux conservateurs. Mais cela ne fonctionne tout simplement pas.
Le fait que les parents veuillent faire le bien par la violence est une contradiction que les enfants ne peuvent pas résoudre.
Qu'est-ce qui fonctionne à la place ?
Parler, parler, parler. L'éducation n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c'est un processus. Je le vois avec ma propre fille : à un moment donné, on constate soudain avec joie que quelque chose a fonctionné. Ce n'est pas en frappant qu'on gagne le respect, mais on détruit la confiance en sa propre autorité. Le fait de vouloir faire le bien avec le mal est une contradiction que les enfants ne peuvent pas résoudre.
Quelles sont les conséquences concrètes du recours à la violence dans l'éducation ?
La recherche neurologique l'a montré : Dans le cerveau, la violence endommage les zones dans lesquelles se trouvent le contrôle de soi et la capacité d'empathie. A cela s'ajoute la peur que ressentent les enfants concernés : La violence génère un vécu de stress très fort qui empêche de reconnaître des comportements alternatifs dans les situations de conflit. Et la violence parentale est une expérience d'impuissance qui détruit l'estime de soi de l'enfant.
La formule est-elle valable ? Celui qui a été battu par ses parents bat aussi ses enfants ?
Heureusement, ce n'est pas vrai à cent pour cent. On constate que la part de la violence dans l'éducation diminue de génération en génération. Il n'en reste pas moins que l'affirmation a du sens : il est prouvé que les personnes qui ont subi de la violence dans leur éducation y ont plus souvent recours elles-mêmes.
Les garçons sont-ils plus souvent battus que les filles ?
Dans notre évaluation, nous n'avons pratiquement pas constaté de différences entre les sexes en ce qui concerne l'expérience de la violence. D'autres études ont toutefois montré que les mères frappent plus souvent leurs filles et les pères leurs fils.
Vous l'avez mentionné au début : en Suisse, contrairement à l'Allemagne, il n'existe pas encore d'interdiction des châtiments corporels. Pourquoi ?
En Suisse, on est encore très réticent à l'idée que la politique s'immisce dans la famille. Mais je pense que dans ce pays aussi, il y a des changements : La création de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA), par exemple. Je perçois de manière générale une volonté accrue d'intervenir lorsqu'un enfant souffre de la situation au sein de sa famille.
Quelle est l'importance d'une telle interdiction ? L'exercice de la violence sur les enfants est déjà interdit aujourd'hui.
Très important : des études menées dans des pays où les châtiments corporels sont interdits montrent que la loi a un fort effet de signal. La Suisse ne pourra plus se soustraire à cet effet. Je pense qu'il faudra encore quelques années pour que certains conseillers nationaux âgés soient remplacés par des jeunes plus ouverts, qui apporteront leur savoir : La violence dans l'éducation est dépassée.
Deux jeunes sur trois subissent des châtiments corporels à la maison
Le professeur Dirk Baier et son équipe de la Haute école zurichoise des sciences appliquées ZHAW ont étudié les conséquences de la violence parentale dans l'éducation en Suisse et ont interrogé à cet effet quelque 8300 élèves d'écoles professionnelles, de gymnases et d'autres écoles du degré supérieur dans différents cantons de toutes les régions de Suisse.
Les principaux résultats de l'étude sur la violence dans les familles en Suisse :
- 62,1 Prozent der Jugendlichen haben Züchtigung erlebt (Ohrfeige oder hartes Anpacken bzw. Stossen). Ohrfeigen haben 53.7 Prozent der Jugendlichen erhalten. 8.7 Prozent sagen, sie haben häufig Züchtigungen erlebt.
- 22 Prozent der Befragten haben in ihrer Erziehung schwere Gewalt erlebt, 5 Prozent von ihnen häufig. Am häufigsten gaben die Jugendlichen an, mit einem Gegenstand geschlagen worden zu sein.
- 32.1 Prozent der Jugendlichen mit Migrationshintergrund gaben an, schwere elterliche Gewalt erlebt zu haben, bei den Jugendlichen ohne Migrationshintergrund waren es 10.9 Prozent.
- Bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund Sri Lanka gaben 50.3 Prozent an, schwere Gewalt erlebt zu haben. Bei Brasilien waren es 45.5 Prozent, Kosovo 40.7 Prozent, Portugal 36.7 Prozent, Türkei 26.2 Prozent und Frankreich 20.4 Prozent.
L'étude peut être consultée ici. On y trouve d'autres corrélations, comme le fait que l'on recourt davantage à la violence en ville qu'à la campagne, ainsi que des chiffres comparatifs avec la situation en Allemagne.
Image : Fotolia
En savoir plus sur la violence au sein de la famille :
- Une éducation sans coups ; c'est aussi ce pour quoi s'engage l'association Gewaltfreie Erziehung. Avec une pétition pour une modification de la loi.
- La gifle n'est pas la seule à faire des dégâts. Violence verbale : quand les mots blessent l'âme des enfants.
- Que peuvent faire les parents lorsque leurs enfants sont agressifs ?