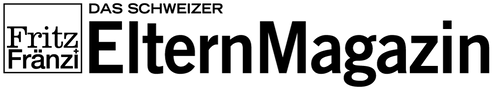«Est-il encore justifiable de mettre des enfants au monde ?»
Madame Bleisch, pourquoi décidons-nous d'avoir des enfants ?
C'est une question difficile. La plupart de ceux qui ont des enfants ne pourraient pas y répondre. Beaucoup diraient sans doute qu'ils ont simplement ressenti le désir d'avoir un enfant. Certains aspirent à la forme de vie spécifique qu'implique la parentalité. D'autres souhaitent assumer la responsabilité d'un être, transmettre leurs propres idées et valeurs ou aimer inconditionnellement un petit être humain et être également aimés par lui.
Le désir d'enfant est un mélange d'attentes sociales et culturelles, de causes biologiques, de désirs intimes et de représentations d'une vie réussie. Le réduire à l'instinct de procréation n'est pas plausible.
En s'engageant auprès d'un enfant, on s'expose à une grande vulnérabilité personnelle.
Pour quelle raison ?
Affirmer que le désir d'enfant répond à une nécessité biologique et qu'il est donc «naturel» de le satisfaire signifierait que les personnes qui n'éprouvent pas ce désir sont en quelque sorte déficientes. En outre, un tel biologisme rapprocherait le fait d'avoir des enfants de l'instinct sexuel. Or, nous pouvons aujourd'hui vivre la sexualité indépendamment de la question de la procréation. En outre, il est également possible de se distancer des désirs «naturels» et de donner la priorité à d'autres désirs, par exemple professionnels.

Qu'est-ce qui distingue le fait de devenir parent d'autres grands «projets de vie» ?
La décision d'avoir des enfants est sans doute l'une des plus existentielles que l'on puisse prendre. Elle est irréversible : On reste parent toute sa vie. Et elle est exclusive : il n'est généralement pas possible d'être seulement un peu père ou mère, on devient plutôt le premier interlocuteur de l'enfant. De plus, on s'aventure en terrain inconnu : on ne sait pas comment sera son enfant, on ne peut pas anticiper son tempérament ni savoir s'il s'égarera un jour. En s'engageant auprès d'un enfant, on s'expose à une grande vulnérabilité.
De plus, on ne sait pas comment changer soi-même.
C'est vrai. Beaucoup disent que lorsqu'ils sont devenus parents, ils sont eux-mêmes nés de nouveau. En fait, être parent est une autre forme d'existence sociale. Être parent est peut-être même l'une des plus grandes aventures dans lesquelles nous puissions encore nous engager dans notre monde sécurisé et organisé.
Mais les enfants rendent-ils également heureux ? En d'autres termes, les parents sont-ils les personnes les plus heureuses ?
Il existe de nombreuses études sur cette question, dont certaines se contredisent massivement. La tendance est que les parents sont plutôt plus malheureux que les couples sans enfant pendant la phase de la petite enfance. Avec l'âge des enfants, le sentiment de bonheur parental augmente à nouveau, pour dépasser ensuite, à l'âge des grands-parents, le sentiment de bonheur des personnes sans descendance. Ce qui me dérange dans ce genre d'études, c'est que la notion de bonheur en sciences sociales est unilatérale.
De quelle manière ?
Le bonheur est généralement assimilé à la satisfaction de la vie, et celle-ci dépend aussi du fait que nous dormions suffisamment, que notre relation avec notre partenaire soit solide et que nous ayons du temps pour nous. Mais si l'on part d'une notion du bonheur plus proche du sentiment de sens, les parents sont souvent plus heureux que les personnes sans enfants. Avoir des enfants semble avoir un sens pour beaucoup.
Les enfants changent, et notre relation avec eux aussi.
La vie quotidienne avec des enfants en bas âge, en particulier, peut être très éprouvante.
Et physiquement épuisant. Je me vois encore avec mes deux filles, l'une dans les bras, l'autre dans la poussette, des sacs de courses encore à l'autre main, pas d'ascenseur dans la maison. Mais c'était aussi une période très intime, où les enfants étaient tout à fait en sécurité dans vos propres bras et couraient à votre rencontre lorsque vous rentriez à la maison.
Et cela manque plus tard ?
Les enfants changent, et notre relation avec eux aussi. Pour le philosophe Emmanuel Kant, le rôle des parents est avant tout d'éduquer les enfants à la maturité. Les parents ne possèdent pas leurs enfants, ils ne font que les accompagner et doivent les rendre libres. Cela signifie donner un cadre dans lequel la liberté peut s'exercer. Le plus difficile est de savoir dans quelle mesure ce cadre peut et doit être perméable.
Avec le début de la puberté, les relations entre parents et enfants deviennent souvent plus difficiles.
Dans les amitiés aussi, il y a des phases où l'on ne s'entend pas très bien, où les conversations sont plus difficiles parce que les deux évoluent dans des directions différentes, mais on finit par se retrouver et l'amitié se développe peut-être même grâce à cette crise. C'est la même chose avec les enfants.
Il y a des phases où l'on connaît très bien ses enfants. Puis ils franchissent une étape de leur développement et on se demande peut-être si on connaît encore son propre enfant. Mes filles ont maintenant 10 et 12 ans. Quand elles rentrent à la maison, elles me demandent souvent ce que j'ai fait et comment s'est passée ma journée. Le fait qu'elles veuillent aussi savoir comment je vais m'émeut encore à chaque fois.
Aujourd'hui, la liberté de choix a pour conséquence que les enfants sont de plus en plus soigneusement intégrés dans la biographie personnelle. On pourrait même dire que les enfants deviennent le projet des parents, dans lequel on investit non seulement de l'argent, mais aussi beaucoup de temps, d'énergie et de connaissances.
C'est certainement vrai. Mais je ne porterais pas un jugement si négatif sur cette évolution. Nous savons aujourd'hui plus précisément ce dont un enfant a besoin, nous avons la possibilité de faire appel à des experts si nécessaire ou de soutenir les enfants de manière ciblée. Cela montre tout d'abord que nous voulons ce qu'il y a de mieux pour nos enfants et que nous avons aussi les ressources pour nous occuper d'eux en connaissance de cause. Le fait que les enfants ne soient plus aujourd'hui la prévoyance vieillesse de leurs parents ou une main-d'œuvre utile est certainement une évolution bienvenue.

À partir de quel moment cette évolution a-t-elle un effet néfaste sur l'enfant ?
Lorsque l'enfant ne s'appartient plus, mais qu'il doit dérouler les plans que ses parents ont pour lui. Chaque enfant a le droit d'avoir un avenir ouvert : de pouvoir donner de l'espace à ses propres goûts et opinions et de devenir la personne qu'il veut être.
En outre, les enfants ont des prédispositions et ne peuvent pas être formés et encouragés à volonté. Si les parents ignorent les prédispositions de leur enfant et pensent qu'ils peuvent tout faire en l'encourageant suffisamment, ils se trompent et le brident d'une manière qui lui est préjudiciable.
Les parents ne devraient pas vouloir éduquer leurs enfants pour qu'ils réussissent, mais pour qu'ils soient heureux.
Cette attitude ne comporte-t-elle pas un danger pour les parents eux-mêmes ?
En effet, dans notre société, les parents sont devenus des sortes de coachs de vie pour leurs enfants. Ils sont rapidement rendus responsables de la réussite ou de l'échec de leurs enfants, comme si ce qu'ils deviennent dépendait uniquement des parents. Les enfants apportent, comme nous l'avons dit, des prédispositions et un caractère. Et d'ailleurs, comment définir le «succès» ? Les parents ne devraient pas vouloir éduquer leurs enfants pour qu'ils réussissent, mais pour qu'ils soient heureux.
N'est-ce pas plus facile à dire qu'à faire ?
Il n'est certes pas facile de se soustraire au marché des offres de soutien et de formation. Les enfants en bas âge peuvent déjà suivre des cours de musique, un ballet, une garderie bilingue. L'impératif de l'optimisation de soi se propage des adultes aux enfants : la vie comme une compétition permanente, dans laquelle nous nous maintenons plus en forme, plus intelligents, plus performants que notre vis-à-vis.
On suggère en permanence aux parents que leur enfant sera désavantagé s'ils ne prennent pas telle ou telle mesure. Il ne semble plus suffisant d'offrir à l'enfant un nid douillet. Il est de plus en plus difficile de rester serein en tant que parent et de croire que l'enfant trouvera sa place.
Les parents devront-ils à l'avenir se demander s'il est encore éthiquement justifiable de mettre au monde des enfants ou d'en avoir d'autres ? Dans votre nouveau livre «Kinder wollen», un sous-chapitre traite de la question de savoir dans quelle mesure le débat sur le climat aura, ou peut avoir, une influence sur le planning familial.
Une étude menée en 2017 par les universités de British Columbia et de Lund conclut qu'une personne pourrait économiser 0,8 tonne de dioxyde de carbone par an en renonçant à la viande, et 2,4 tonnes en vivant sans voiture. Le fait de renoncer à avoir un enfant représenterait quant à lui 58,6 tonnes. Au vu de ces résultats, nous devrions également repenser le fait d'avoir des enfants, a demandé le groupe de réflexion «Club of Rome».
Et renoncer aux enfants pour protéger le climat ?
Ou du moins ne pas fonder une grande famille. Mais les chiffres et la méthode de mesure ont également été mis en doute. Par exemple, il n'a pas été tenu compte du fait que les générations futures vivront, espérons-le, de manière plus écologique grâce aux mesures de protection du climat. Ou que le taux de natalité est de toute façon en baisse dans de nombreux pays industrialisés et que les enfants des pays en développement ont une empreinte écologique nettement plus faible en raison de leur niveau de vie différent.
Il n'existe en principe aucun droit à un geste de gratitude particulier.
Observez-vous une tendance chez les jeunes à avoir moins d'enfants ?
Des chercheurs en sciences sociales devraient répondre à ces questions. Ce qui me frappe, c'est que les différentes générations réagissent différemment aux exigences mentionnées. La génération de mes parents trouve l'idée de renoncer à avoir des enfants pour des raisons de protection du climat plutôt absconse ; la mienne y trouve déjà plus d'intérêt ; quant aux étudiants de l'université, ils discutent abondamment de cette question.
Et la soi-disant jeunesse climatique ?
Elle ne se décide évidemment pas maintenant pour ou contre des enfants. Mais une certaine «peur de l'avenir» va certainement de pair avec la question de savoir dans quel monde on laisse les enfants. D'un autre côté, les parents ont peut-être une bonne raison de s'engager pour une politique écologique - en faveur d'un avenir digne d'être vécu pour les enfants.
Pas les personnes sans enfants ?
Ce serait une insinuation grossière. Je le formulerais plutôt dans l'autre sens : Avoir des enfants nous oblige peut-être particulièrement à réfléchir au moins au monde que nous laisserons aux générations futures. Car, comme l'écrit le philosophe Leander Scholz, les enfants créent une «relation avec un avenir» qui s'étend bien au-delà de notre propre époque.
Votre dernier livre «Pourquoi nous ne devons rien à nos parents» a fait sensation. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur ce sujet ?
D'une part, nous avons tous des parents et nous nous demandons probablement tous de temps en temps comment gérer les exigences de nos propres parents - surtout si nous tenons à une bonne entente avec eux. D'autre part, je suis moi-même devenue mère, j'ai été reconnaissante de l'aide apportée par mes propres parents et j'ai vu qu'ils s'occupaient également de mes grands-parents. J'ai commencé à me demander comment nous pouvions réfléchir intelligemment aux attentes des familles, afin qu'elles soient heureuses et que chacun puisse s'épanouir.
Et vous êtes arrivé à la conclusion que les enfants ne doivent rien à leurs parents ?
Oui, pour plusieurs raisons, auxquelles je réfléchis en détail dans le livre. Avant tout, je pense que l'idée de culpabilité est non seulement injustifiée, mais qu'elle ne mène à rien. Les parents ne veulent pas que leurs enfants fassent des efforts pour eux parce qu'ils se sentent coupables, mais parce qu'ils s'intéressent l'un à l'autre et à leur relation.
Mais ne devrions-nous pas au moins être reconnaissants envers nos parents ?
La gratitude est une vertu essentielle dont j'aime souligner la valeur. Les personnes reconnaissantes sont en outre plus heureuses, comme le montrent de nombreuses études. Mais la question cruciale est de savoir si la gratitude nous permet de déduire que nous devons quelque chose à nos parents, ce à quoi ils ont droit à leur tour. Cela ne me semble pas être le cas. La gratitude peut se manifester de différentes manières. Il n'y a pas de droit à un geste de gratitude particulier.
Et inversement ? Que doivent donc les parents à leurs enfants adultes ?
La question ne peut pas être retournée une à une et je n'ai pas encore de réponse définitive à cette question. En tant que mère ou père, on donne vie à un être humain. Cela implique certainement une responsabilité. Dans l'idéal, cette responsabilité prend fin lorsque l'enfant devient autonome et peut - et veut d'ailleurs - s'occuper de lui-même.
Mais que se passe-t-il si ce n'est pas le cas ? Si l'enfant est malade et ne pourra jamais mener une vie autonome ? Ou s'il traverse une crise à l'âge adulte ?
Je ne pense pas que l'on puisse, en tant que parents, se contenter d'affirmer que notre responsabilité s'arrête à la majorité de l'enfant. Au contraire, le fait que nous ne puissions jamais savoir si l'enfant pourra trouver et suivre sa voie fait sans doute partie des risques de la parentalité. Mais il est bien sûr aussi du devoir de la société de soutenir les parents qui sont surchargés par la garde de leurs enfants.

Prenons un exemple : une vieille femme n'est plus en mesure de vivre seule et souhaite que l'un de ses trois enfants adultes l'accueille et s'occupe d'elle. Tous les trois disent non. En ont-ils le droit ?
Cela dépend bien sûr du système social dans lequel cette femme vit. S'il y a la possibilité de bien placer la femme dans une maison de soins, les enfants n'ont pas l'obligation de changer complètement de vie. Dans une société où le système social n'est pas suffisamment bon, les parents peuvent être totalement dépendants de leurs enfants. Ils se trouveraient alors dans une situation de détresse dont seuls les enfants pourraient les sortir. L'aide d'urgence est alors obligatoire.
Et une mère peut-elle refuser si sa fille adulte lui demande de garder ses enfants ?
Oui, avoir des enfants signifie assumer la responsabilité de ceux-ci. Mais les parents ne sont pas également responsables des enfants de leurs enfants. Je trouve au contraire que la contribution sociale des grands-parents n'est pas assez reconnue. Il s'agit d'un travail bénévole considérable, sans lequel beaucoup de choses ne fonctionneraient pas !
Livre conseillé
Est-ce que ce sera un jour au tour des enfants qui grandissent de donner quelque chose en retour à leurs grands-parents ?
Cela dépend de la relation entre les grands-parents et les petits-enfants. Dans le livre, je plaide pour troquer le regard transactionnel contre un regard relationnel. En d'autres termes : ne pas se demander ce que je dois donner en retour. Mais plutôt de se demander : que signifie cette relation pour moi ? Comment puis-je l'entretenir pour qu'elle réussisse ? Les relations ne peuvent réussir que si nous les nourrissons, si nous investissons en elles - mais pas si nous nous abandonnons ou si nous les renions complètement.
Cela vaut également pour la relation parents-enfants : la relation avec nos parents est irremplaçable et personne ne l'abandonne à la légère. Mais si les enfants ne peuvent pas s'épanouir ou se voient constamment contraints ou contrôlés dans leurs projets de vie, ils devront se libérer de la famille.