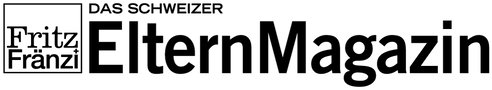Enfants adoptés : la rupture dans l'enfance
Normalement, les enfants naissent dans une famille et y grandissent aimés, soutenus et attachés. Les enfants aiment savoir d'où ils viennent et à qui ils appartiennent. Mais tous les enfants ne font pas cette expérience. Les enfants adoptés connaissent une rupture dans leur parcours de vie : A un moment donné, ils prennent conscience qu'il n'est pas si facile de répondre à la question de leur propre identité.
Développer sa propre identité, c'est se créer une image congruente de soi-même. Une image d'être une personne à part entière, avec certaines caractéristiques et positions dans le monde, une histoire congruente propre, des sentiments et des jugements personnels vis-à-vis de soi-même. C'est ainsi que nous souhaitons être perçus par les autres. Le sentiment d'identité du moi est une sorte de concordance entre le propre moi perçu et ressenti et celui qui apparaît aux yeux des autres.
La connaissance des origines est un droit humain qu'une personne peut ou non exercer.
Alors que les enfants construisent leur propre identité en imitant les personnes auxquelles ils s'attachent et en cherchant des similitudes, l'adolescence marque le début du détachement des personnes auxquelles ils s'attachent et de la construction d'un moi autonome. Des questions telles que «Qu'est-ce qui me caractérise ?» et «Comment me distinguer des autres ?» prennent une grande importance, en particulier à l'adolescence. C'est une tâche de développement typique que nous devons tous maîtriser.
La relève, un exercice d'équilibre
Construire sa propre identité signifie aussi se distinguer de certaines personnes et de certains groupes et se joindre à d'autres auxquels on se sent appartenir. Dans le contexte familial, il n'est pas rare que cela signifie se distinguer des parents et rechercher l'appartenance auprès des pairs . Les parents et les pairs ne sont pas les mêmes.
Le détachement des parents peut être vécu par les jeunes d'une part comme une libération, d'autre part comme une perte de repères. Cela peut être source d'incertitude et d'angoisse pour les parents comme pour les adolescents.
Entre parents et adolescents, ce processus de détachement peut donner lieu à des discussions douloureuses et houleuses sur la manière de construire une nouvelle cohabitation. Laisser l'adolescent suivre son chemin tout en étant là quand il en a besoin est donc souvent un exercice d'équilibre.
Qui suis-je ?
Lorsqu'une personne fait l'expérience qu'elle peut être ce qu'elle est, que son histoire est unique et particulière et qu'elle fait partie d'un groupe - malgré ses différences -, une personnalité stable peut se développer. Dans l'idéal, il s'agit d'une personnalité autonome, consciente de sa différence, mais cohérente avec elle-même.
Ne pas savoir d'où l'on vient vraiment peut déclencher de grandes crises.
Chez la plupart des enfants adoptés, la question «Qui suis-je ?» s'accompagne tôt ou tard de la question «D'où suis-je originaire ?». Ces questions sont importantes pour la formation d'une identité propre. Les adolescents adoptés, en particulier, prennent de plus en plus conscience que leur parcours de vie est différent de celui de leurs collègues et amis. Ne pas savoir d'où l'on vient réellement, pourquoi les parents biologiques n'ont pas pu ou voulu s'occuper de nous, d'où proviennent certaines caractéristiques et où l'on appartient, peut déclencher de grandes crises.
Quand une partie de sa propre histoire manque
Une partie de sa propre origine est inconnue : Où s'orienter si je ne trouve pas de concordances ? A l'identification avec les parents sociaux s'ajoute l'identification avec les parents biologiques, qui ne sont toutefois pas connus. Une partie de sa propre histoire manque.
Il n'est pas possible de vérifier et d'évaluer soi-même la réalité. En réaction, les parents biologiques peuvent être glorifiés, mais les parents biologiques et sociaux peuvent également être rejetés. Les incertitudes sont encore renforcées lorsque l'adolescent ne peut pas poser ouvertement ces questions sur ses origines, par exemple pour ne pas blesser les parents qui s'occupent de lui.
Plusieurs études démontrent que la clarté sur sa propre histoire, même si elle est dure, facilite la construction de l'identité et la recherche d'une place dans la société. Connaître les raisons et les causes de l'autorisation d'adopter peut également avoir un effet réconciliateur et renforcer l'estime de soi. En ce sens, la connaissance de la filiation est en soi un droit humain qu'une personne peut ou non exercer.
Nouvelle disposition légale
Depuis 1973, les adoptions en Suisse n'étaient possibles que sous forme d'adoption plénière et en gardant secrète l'identité de la famille adoptive . Les liens avec les parents biologiques étaient coupés, ce qui entraînait l'extinction des liens de parenté. Le législateur partait alors du principe que pour que l'adoption plénière puisse avoir lieu, il fallait non seulement une séparation juridique, mais aussi une séparation informationnelle entre les parents biologiques et l'enfant.
Depuis le 1er janvier 2018, une nouvelle réglementation est en vigueur, qui permet aux parents biologiques, sous certaines conditions, de prétendre à la connaissance des données personnelles de leurs enfants adoptés. Depuis cette révision, l'enfant adopté et les parents adoptifs ont en principe toujours droit au respect du secret de l'adoption.
Accès conditionnel aux informations pour les parents biologiques
Tant que l'enfant n'est pas capable de discernement ou si l'un des parents ne consent pas à la communication des informations, le secret de l'adoption est préservé. Si l'enfant est capable de discernement sur ce point et que les parents adoptifs et l'enfant ont consenti à la communication, des informations d'identification concernant l'enfant mineur ou ses parents adoptifs peuvent être communiquées aux parents biologiques.
L'enfant a le droit d'être sûr.
Si l'enfant majeur a donné son consentement à la communication, des informations d'identification le concernant peuvent être communiquées à ses parents biologiques ainsi qu'à leurs descendants directs. Il s'agit d'informations qui permettent de tirer des conclusions directes sur sa personne. Il peut s'agir de ses données personnelles, mais aussi d'informations permettant de savoir facilement de qui il s'agit. Ainsi, les descendants directs des parents biologiques, c'est-à-dire également les frères et sœurs biologiques, ont désormais la possibilité d'obtenir des informations sur l'enfant placé en vue d'une adoption.
Contrairement à l'accès limité à l'information pour les parents biologiques, l'enfant adopté a lui-même le droit d'obtenir des informations sur l'identité de ses parents biologiques. L'enfant a également le droit de savoir qu'il a été adopté. Les parents adoptifs sont libres de choisir le moment et la manière dont ils souhaitent informer l'enfant adopté. Ils sont toutefois tenus d'en informer l'enfant et ne peuvent pas le priver de cette information.
Mission de l'APEA
Si les parents biologiques et les parents adoptifs se connaissent, ils peuvent aussi décider d'une adoption ouverte. Contrairement à l'adoption secrète, l'adoption ouverte implique des contacts entre les parents biologiques, les parents adoptifs et l'enfant adopté. L'accord sur les contacts ainsi que les éventuelles modifications sont soumis à l'approbation de l'APEA.
L'APCE a l'obligation de faire prendre conscience aux personnes impliquées dans l'accord de la portée de leur décision. L'enfant doit également être consulté avant l'approbation de la convention. S'il est déjà capable de discernement sur cette question, son consentement est nécessaire. L'accord ne peut pas être modifié ou même annulé unilatéralement.
L'enfant adopté dispose d'un droit de veto : s'il refuse un contact avec ses parents biologiques, il n'est pas obligé de tolérer un contact avec ses parents biologiques malgré l'accord existant. De même, les informations telles que les bulletins scolaires ou les photos ne peuvent pas être transmises par les parents adoptifs contre sa volonté. Outre ce cadre juridique, d'autres mesures peuvent être prises pour relever les défis d'une adoption ouverte.
La série en bref
- PARTIE 1 Relation parents - enfant
- PARTIE 2 Être parent - rester en couple
- PARTIE 3 Être père, mère, parents
- PARTIE 4 Garde des enfants par les parents
- PARTIE 5 Frères et sœurs
- PARTIE 6 Adoption
- PARTIE 7 L'État et la famille
- PARTIE 8 Modèles de famille
- PARTIE 9 Des racines et des ailes
- PARTIE 10 Droit de contact
Des informations trop tardives ébranlent la confiance dans les personnes de référence
Pour que l'enfant adopté puisse comprendre et accepter sa situation de vie, il est important qu'il reçoive le plus tôt possible des informations sur qui il est et d'où il vient. Ces informations doivent être aussi claires que possible et adaptées à l'âge de l'enfant, afin qu'il puisse les classer. Les témoignages d'enfants adoptés qui n'ont appris que tardivement qu'ils avaient été adoptés montrent clairement que leur confiance dans les personnes qui les entourent, en particulier dans les parents d'accueil, est fortement ébranlée.
Des études montrent que les enfants adoptés dont les familles ont été ouvertes très tôt à leurs parents d'origine ou qui ont connu personnellement leur famille biologique se portent mieux psychologiquement et ont une plus grande confiance en eux. Cela plaide en faveur d'une ouverture d'esprit affectueuse pour donner aux enfants, quelles que soient leurs conditions de vie, la confiance qu'ils comprendront leur histoire et qu'ils seront capables de l'assumer.
Pour cela, il faut des adultes capables de supporter les hauts et les bas de l'ambivalence enfantine et adolescente et qui accompagnent les enfants avec beaucoup de patience et de confiance. Même s'il y a des crises et des conflits de loyauté. Car il est important de les surmonter pour pouvoir suivre son propre chemin vers une identité stable.