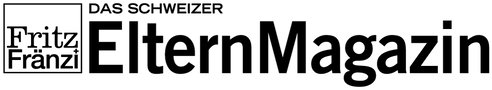En visite à l'école de l'asile
Le matin, un petit bus monte la petite route escarpée qui traverse l'enceinte de l'hôpital cantonal. Il s'arrête devant le dernier bâtiment à l'orée de la forêt et recrache un groupe d'élèves avec des sacs à dos colorés. Ils se hâtent de passer devant la réception du centre d'asile et le bureau devant lequel des demandeurs d'asile sont assis, attendent, discutent à voix haute. Les enfants sont en retard ce matin-là, car leur bus scolaire est resté bloqué dans les embouteillages. Ils enlèvent frénétiquement leurs vestes, les répartissent sur les crochets accrochés au mur et se précipitent dans la salle de classe. Leurs camarades y sont déjà assis, penchés sur leurs devoirs. Ils ont eu un trajet plus court pour aller à l'école : des étages supérieurs du centre d'asile au rez-de-chaussée. Les enseignantes acceptent avec calme l'arrivée tardive des enfants du bus scolaire en provenance des autres centres d'asile. Ici, la situation exceptionnelle est la norme.
Les cantons appliquent des modèles différents
A l'école du centre de requérants d'asile Hirschpark à Lucerne, la rentrée a lieu toutes les deux semaines. Presque aussi souvent, les élèves prennent congé. Au moment de notre visite, 48 enfants et adolescents bachotent dans six classes, mais le nombre change constamment - la plupart du temps, il augmente. En Suisse, tous les enfants sont obligés d'aller à l'école - indépendamment de leur statut de séjour. Avec l'afflux croissant de réfugiés, il y a donc aussi de plus en plus d'enfants qui attendent dans les centres de transit cantonaux que leur demande d'asile soit traitée. Pendant cette période déjà, l'éducation est pour eux à la fois un droit et un devoir. Les cantons appliquent les modèles les plus divers. De l'intégration immédiate dans l'école normale avec des cours d'allemand supplémentaires, en passant par des classes spéciales à effectif réduit, jusqu'aux classes directement dans les centres d'asile, comme c'est le cas à Lucerne. Une fois le statut d'asile clarifié, les candidats retournent soit dans les communes - et donc dans les écoles ordinaires - soit dans leur pays d'origine. En moyenne, les enfants de Lucerne restent deux à trois mois dans les centres de transit. Mais il y a toujours ceux qui repartent après quelques semaines déjà. Et il y a ceux dont le statut reste incertain jusqu'à un an ou plus.
«Nous ne pouvons pas enseigner à un jeune analphabète de 16 ans avec des élèves de maternelle et de primaire».
Directrice de l'école Silvia Rüttimann
Chaque élève doit être pris en charge individuellement
Ils voient leurs camarades de classe aller et venir en permanence. L'écart est énorme Avant d'être répartis dans les classes, les enfants se présentent à la directrice de l'école, Silvia Rüttimann. Elle essaie de savoir si les enfants ont déjà été à l'école, s'ils savent lire et écrire, s'ils ont aussi appris les caractères latins ou principalement arabes. «L'écart est énorme», dit-elle. Selon elle, la tâche la plus difficile consiste certes à répartir les enfants par niveau, mais aussi à leur donner la chance d'apprendre avec des enfants de leur âge. «Nous ne pouvons pas mettre l'analphabète de 16 ans avec les élèves du primaire et du jardin d'enfants», dit-elle. Pour les huit enseignantes de l'école primaire qui travaillent à un taux fixe à l'école du centre d'asile, cela signifie surtout une chose : elles doivent s'occuper de chaque élève individuellement. Attribuer à chacun des tâches à son niveau, lui permettre de progresser tout en maintenant la cohésion du groupe. Un exercice d'équilibriste permanent.
C'est pourquoi les salles de classe ne comptent généralement pas plus de dix élèves. L'acquisition de la langue est au premier plan, tous les enseignants ont une formation complémentaire dans le domaine de l'allemand langue étrangère. Le matin, chaque élève a dix leçons d'allemand par semaine. L'après-midi, deux leçons de calcul, deux leçons d'arts plastiques et deux leçons de sport sont inscrites à l'emploi du temps. Et puis il y a des choses qui sont apprises en même temps, sans être nommées directement : donner une structure à la journée, devenir capable d'aller à l'école.
«Les enfants absorbent tout, veulent tout savoir, sans aucune réserve».
Professeur Pia Schnyder Perrollaz
C'est justement le cas des plus jeunes, les futurs élèves du primaire. Ils sont assis à de petites tables au premier étage et collent des points colorés derrière des images et des mots. Chaque point représente une syllabe. Ceux qui ne sont pas sûrs d'eux tapent dans leurs mains avec l'enseignante Pia Schnyder Perrollaz et le stagiaire Anis Ayachi et comptent. «Re-gen-parapluie». «Tempête-vent». Les enfants viennent d'apprendre ces mots - ils sont tirés d'une histoire de hérisson en hibernation. Certains élèves se creusent la tête et réfléchissent si fort qu'on croirait presque voir de la vapeur s'échapper de leurs petites têtes. Ils se frottent le nez, contractent la bouche et essaient : «Deux ? "Non, écoute encore une fois !» D'autres soupirent et s'agitent impatiemment sur leurs chaises.

Mais il y a aussi l'autre côté du travail au centre d'asile. L'enthousiasme sans précédent des enfants. Chaque fois que Pia Schnyder Perrollaz pose une question, tous les doigts se lèvent avec avidité et les enfants s'exclament «Moi, moi, moi ...». «Ils absorbent tout, veulent tout savoir, sans aucune réserve», raconte l'enseignante. En même temps, ils recherchent la proximité. Le stagiaire Anis, 22 ans, leur plaît particulièrement. Peut-être parce qu'il est à moitié tunisien et qu'il parle l'arabe. Peut-être aussi parce que, comme il le dit lui-même, «il n'a pas besoin de faire preuve d'autant d'autorité et peut parfois simplement s'asseoir». Régulièrement, l'un des enfants s'approche de lui et se blottit contre son bras. Même lorsqu'à la fin de la leçon, ils chantent ensemble la chanson du hérisson en hibernation, à voix haute, de manière erronée et avec beaucoup d'engagement corporel. La directrice Silvia Rüttimann sait par expérience que la plupart des enfants aiment aller à l'école et qu'il n'est pas nécessaire de convaincre les parents. «Pour tous, l'école est extrêmement importante». Et pas seulement pour la matière scolaire. Il s'agit aussi de sortir les enfants des conditions de logement exiguës du centre d'asile. On le voit bien avec la famille Rashid. Depuis qu'elle a quitté la Syrie il y a trois mois pour venir en Suisse en passant par la Turquie et l'Allemagne, elle habite deux étages au-dessus de l'école dans une petite chambre impeccablement nettoyée. Il y a deux lits superposés et un petit lit à barreaux avec un nouveau-né. Un lavabo, un four à micro-ondes, un réfrigérateur et une petite table - c'est tout. C'est ici que vit la famille de six personnes. Et tous essaient de se taire lorsque les trois enfants en âge d'aller à l'école font leurs devoirs. C'est ce qu'assure le père Muhammed, que l'on rencontre souvent lui-même avec son dictionnaire. «L'éducation est importante», dit-il avec un visage sérieux. Il se tient devant un mur sur lequel sont accrochés les horaires des enfants, accompagnés de photos-portraits. En dessous, le pupitre de l'école et les chaussures sont alignés. Jusqu'à il y a quelques mois, le centre d'asile disposait encore d'une salle où les enfants pouvaient faire leurs devoirs en toute tranquillité. Mais cette pièce est désormais utilisée comme dortoir supplémentaire.

Habituer les enfants aux structures scolaires est tout sauf facile, rapporte l'enseignante : «Beaucoup ne se sont jamais assis en cercle auparavant, certains n'ont jamais joué». A cela s'ajoute le fait que certains enfants apportent avec eux un fort potentiel d'agressivité - ils n'ont pas connu autre chose dans leur famille. «Celui qui a le jouet en main pense qu'il lui appartient désormais, et les autres sont repoussés par des coups et des griffures», raconte Pia Schnyder Perrollaz. Dans ces moments-là, elle est particulièrement sollicitée en tant qu'enseignante et en tant qu'être humain. Elle doit expliquer pourquoi il ne faut pas frapper dans la salle de classe. Et ce, souvent uniquement par des gestes et des mimiques, parce que les bons mots manquent encore.
Chuchoter sur l'enseignante
Il n'y a que parmi les adolescents que certains ne semblent pas toujours aussi enthousiastes à l'égard des cours. Pour eux, l'enseignante est parfois l'occasion de chuchoter dans leur langue maternelle. Et il y a des garçons qu'il faut rappeler trois fois à l'ordre avant qu'ils n'éteignent leur portable. C'est peut-être dû à la puberté. Peut-être aussi au fait qu'ils ont le chemin le plus difficile à parcourir. En quelques semaines ou mois, les jeunes doivent apprendre l'allemand et acquérir les premiers contenus scolaires de manière à pouvoir bientôt fréquenter «la classe ordinaire la plus basse qui soit encore acceptable pour leur âge». C'est ainsi que s'exprime la directrice Silvia Rüttimann. C'est pourquoi l'ambiance dans ces classes est beaucoup moins ludique que chez les plus jeunes.
On y conjugue des verbes avec vigueur. «J'embrasse, tu embrasses ...». «Sais-tu ce que signifie embrasser ?», lance l'enseignante, et la fillette afghane forme timidement une bouche de baiser sous son foulard. «Oui, c'est ça !» Puis elle félicite une Erythréenne d'avoir conjugué correctement le verbe «courir» - sans lire, car elle ne sait pas encore lire. Une salle de classe plus loin, l'enseignante Heidy Müller lance aussi régulièrement un mot en farsi ou en arabe lorsque la communication est difficile. Mais elle avoue, en faisant son autocritique, qu'elle oublie la plupart des choses peu de temps après que les élèves les lui aient enseignées. «Je trouve d'autant plus admirable ce que les enfants font ici».
La plupart d'entre eux parlent l'allemand avec des phrases courtes. «Je viens de Syrie». «J'ai 14 ans». Ça va. De même : «J'ai deux sœurs». Mais pourquoi celles-ci sont restées avec leurs parents en Syrie, pourquoi le garçon qui raconte cela est venu tout seul en Suisse, les mots allemands manquent encore. Au lieu de cela, il sourit et hausse les épaules. Une chose est sûre : il n'est pas le seul à être ici sans famille. Dans le canton de Lucerne, un centre a été spécialement construit pour environ 70 «UMA», c'est-à-dire des «requérants d'asile mineurs non accompagnés». Un défi particulier pour les enseignants ? Silvia Rüttimann : «Nous ressentons rarement les traumatismes. Ce n'est que ponctuellement qu'un parent raconte quelque chose lorsqu'il s'agit d'expliquer le comportement des enfants». Mais en classe, ce que les enfants ont vécu n'est généralement pas un sujet de discussion. L'enseignante Pia Schnyder Perrollaz en est convaincue : «Les enfants sont d'abord occupés à arriver - ce qu'ils ont à assimiler n'apparaît que bien plus tard, lorsqu'ils ont trouvé le calme».
Lire la suite :
- Und wie geht es weiter nach der Schule im Asylzentrum? Wir haben die 14-jährige Amina bei ihrem Schritt in die Regelschule begleitet.