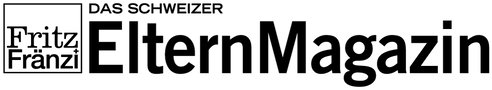En route avec la KESB
Mercredi matin, 8h30. Une file d'attente s'est formée devant la machine à café de la petite cuisine de la KESB à la Weltpoststrasse à Berne. Charlotte Christener, la cheffe, fait la queue comme tout le monde. «Charlotte, as-tu un moment à consacrer à Mme Sonderegger ? Elle est au téléphone». Christine Brauchle, la responsable du secrétariat, passe la tête par la porte ouverte, à peine Christener est-elle devant. Elle acquiesce, hausse les épaules. Le café doit attendre. Deux minutes plus tard, elle déambule dans les couloirs, un casque sur la tête. «Oui, je m'attends aussi à une plainte. Mais que voulez-vous faire ?», dit-elle.
Les personnes qui ne souhaitent rien de bon à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) en général, et à sa cheffe en particulier, ne manquent pas. Il ne se passe guère de semaine sans que l'on entende des titres tels que «SozialIrrsinn bei der KESB», «Mahnwache gegen KESB-Willkür» ou «Schafft endlich die KESB ab».
Charlotte Christener et son équipe ont appris à vivre avec. Les personnes qui prennent chaque jour des décisions sur la vie privée d'autres personnes ne se moquent pas de la critique. «Souvent, nous ne pouvons que choisir de quel côté nous voulons la claque», dira Markus Engel, l'adjoint de Charlotte Charlotte, au cours de la journée. On ne veut pas se laisser influencer. Et encore moins l'intimider.
La plupart du temps, il s'agit de conflits au sein de la famille
9 heures du matin. La première réunion de la journée. Lors de cette réunion interdisciplinaire informelle, l'autorité, composée de sept personnes au total - des juristes, des assistants sociaux et un psychologue -, discute de ses cas difficiles. Markus Engel présente son premier «enfant à problèmes».
La mère, universitaire issue de l'immigration, et le père, bon vivant de la campagne, ont certes l'autorité conjointe sur l'enfant de deux ans, mais ils ont des points de vue tellement différents sur l'éducation des enfants et la vie en général que le père, après diverses disputes, s'est adressé à la KESB. Celle-ci a nommé un curateur d'accompagnement pour l'enfant qui vit chez sa mère. Dans la plupart des cas de protection de l'enfant, il s'agit de conflits entre les parents.
«Nous ne nous laissons pas influencer par la critique. Et encore moins les intimider».
Charlotte Christener et son équipe sont habituées à la critique.
Charlotte Christener sourit : «Une fois de plus, deux opposés complets se sont trouvés». La mère a déposé une demande auprès de la KESB pour pouvoir rendre visite à ses proches dans son pays d'origine avec l'enfant. Le père s'y oppose : peur d'un enlèvement d'enfant. «Qu'est-ce qu'on fait ?», demande Engel en louchant par-dessus le bord de ses lunettes. «Les parents ne sont pas mariés ?», demande l'assistante sociale Franziska Voegeli.
Markus Engel acquiesce : «La mère et l'enfant portent le même nom et ont des passeports valides. Si elle voulait l'enlever, elle pourrait tout simplement prendre l'avion avec l'enfant et n'aurait probablement pas informé le père et le curateur au préalable».
«Quels sont les faits ?», veut savoir Charlotte Christener. La question de la juriste. Et la peur sous-jacente des conséquences d'une décision hâtive. «Nous ne pouvons pas simplement partir du principe, en croisant les doigts, qu'elle va déjà revenir avec l'enfant. Et si ce n'est pas le cas ? Alors nous sommes des poulets !» Markus Engel doit laisser la mère prendre position sur les objections du père. Ensuite, l'affaire sera à nouveau débattue.
Un placement en institution est justifiable
Le cas suivant concerne deux garçons de 15 et 16 ans, arrivés d'Afrique avec des passeurs en Suisse et élevés par leur tante à Berne. Celle-ci a déménagé avec les garçons dans un autre canton, ce qu'elle n'aurait pas dû faire pour des raisons de droit des étrangers. Les garçons se sont enfuis, préférant vivre dans un foyer pour enfants dans la capitale plutôt que chez leur tante dans un environnement qui leur était étranger. «En déménageant illégalement, elle a coupé l'herbe sous le pied des garçons», explique Franziska Voegeli. Cela, ajouté à l'accord des garçons, rend le placement en foyer acceptable.

144 nouveaux retraits de garde ont eu lieu en 2015 dans le canton de Berne. Selon les estimations de Charlotte Christener et de ses collègues, dans un bon 90 pour cent d'entre eux, les personnes concernées auraient compris la nécessité de la mesure au cours du processus. «Ce n'est donc pas, loin s'en faut, comme si nous prenions quotidiennement d'assaut des appartements et faisions enlever leurs enfants à des parents intègres», explique Charlotte Christener.
D'autant plus que chaque dossier ouvert coûte de l'argent. Une phrase revient sans cesse : «Qui va payer ?» Berne est un cas particulier à cet égard : contrairement au canton de Zurich par exemple, où les communes prennent en charge les mesures, à Berne, c'est le canton lui-même qui paie ce que la KESB cantonale ordonne. Cela évite bien des conflits avec la ville, mais ne signifie pas que la KESB se sente à tout moment responsable financièrement de tout.
Le fait que deux des trois cas discutés ce matin concernent des enfants est une exception. En règle générale, seuls trois bons cas sur sept concernent la protection des enfants.
«Ce n'est pas comme si nous faisions prendre d'assaut des appartements et enlever des enfants tous les jours».
Charlotte Christener, présidente de la KESB
Pour le reste, il s'agit généralement de curatelles pour adultes, souvent pour des personnes âgées. La KESB s'en occupe également.
Et les dernières statistiques le prouvent : depuis l'introduction de la KESB en janvier 2013, 1,3 % de mesures de protection de l'enfant en moins ont été prises chaque année dans toute la Suisse. Fin 2012, on en comptait 42 381, en 2015 seulement 40629. «Cela est probablement dû avant tout au fait qu'on essaie aujourd'hui davantage de chercher des solutions dans un cadre volontaire avec les personnes concernées. Si elles y parviennent, les mesures de protection de l'enfant ordonnées par les autorités sont inutiles», explique Charlotte Christener.
«Si le bien de l'enfant est menacé et que les parents n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures appropriées pour protéger l'enfant». C'est ce que dit l'article 307, alinéa 1 du Code civil. Tel est le mandat légal de l'autorité de protection de l'enfant. La difficulté d'exécuter ce mandat se manifeste lors de la séance de 10 heures, au cours de laquelle les décisions actuelles de l'APEA sont discutées et formellement édictées. La première question, décisive, est : «Est-ce que nous faisons quelque chose ?».
Les suppositions ne sont pas des faits
Tout le monde peut faire un signalement de danger. Les fonctionnaires qui constatent le danger dans l'exercice de leur fonction sont tenus de le faire. C'est ce qui s'est passé dans le cas présenté par Franziska Voegeli. L'avis de mise en danger a été émis par la commission scolaire, qui soupçonne des violences domestiques dans le cas de quatre frères et sœurs âgés de neuf à deux ans. Les enfants présentent des troubles du comportement, frappent d'autres enfants et ont raconté à l'école avoir été frappés avec des bâtons et des ceintures. Lors d'une audition, les parents ont déclaré qu'ils n'avaient pas besoin d'aide pour élever leurs enfants, que les éventuelles blessures étaient dues au fait qu'ils jouaient à l'extérieur.
«Difficile», estime Markus Engel. «Pour l'instant, nous en savons tout simplement trop peu». La décision : les parents sont priés de participer activement à une enquête intensive sur place. C'est tout ce que les autorités peuvent et veulent faire pour le moment.
«En cas de soupçon que des parents battent régulièrement leurs enfants, nous devons agir».
Assistante sociale Franziska Voegeli
Franziska Voegeli respire profondément. Le travail social signifie parfois aussi devoir supporter des incertitudes. Les juristes veulent en avoir le cœur net. Si l'on soupçonne que des parents battent régulièrement leurs enfants, il faut agir. Mais justement : Les suppositions ne sont pas des faits. Beaucoup d'hommes et de femmes qui travaillent ici sont eux-mêmes parents. Les murs du bureau de Markus Engel sont également ornés de nombreux dessins d'enfants et les étagères de divers personnages de Star Wars. «Il est vrai que nous avons plus de distance avec les clients que l'autorité de tutelle auparavant, et c'est tout à fait voulu», explique-t-il en fouillant dans ses documents - alignés en piles bien rangées. «Ce n'est plus le voisin qui doit pouvoir décider des questions de droit de la famille. Nous avons une vue d'ensemble de la situation. Les curateurs et les enquêteurs mis à disposition par la commune sont proches de nous. On obtient ainsi une vue d'ensemble».
La distance par rapport aux cas est importante
La KESB Berne ouvre 300 cas de protection de l'enfant par an. «Lorsqu'il s'agit d'enfants, nous préférons ouvrir un dossier de trop plutôt qu'un dossier de moins», explique Markus Engel. Fidèle au principe de la KESB «autant que nécessaire, aussi peu que possible».
Puis il tire une feuille d'un dossier, lit, secoue la tête. «Les maladies psychiques et la violence domestique sont une réalité dans notre société. Les enfants peuvent aussi en être directement ou indirectement affectés. Souvent, les parents atteints dans leur santé mentale ne se rendent pas compte qu'ils sont malades». Bien sûr, en tant que père, certains destins le touchent plus que d'autres. «Mais finalement, l'une des compétences clés des travailleurs sociaux est d'avoir suffisamment de distance».
«La violence domestique est une réalité dans notre société».
Markus Engel, vice-président de la KESB
L'après-midi se déroule tranquillement. Charlotte Christener rend visite à une cliente de la clinique psychiatrique, Markus Engel s'occupe de ses cas. Mais il arrive aussi souvent qu'un appel d'urgence vienne perturber le planning de la journée. C'est ce qui s'est passé récemment lorsqu'un nourrisson a été déposé dans la boîte à bébé de l'hôpital de l'Île. Pour Markus Engel, il s'agissait de tout laisser tomber. Le bébé avait besoin d'un nom, d'une date de naissance, d'un droit de cité, d'un curateur et d'une solution de suivi après son séjour à l'hôpital.
17 heures. Charlotte Christener et son collègue Raffaele Castellani reviennent de la clinique. «Elle ne nous parle plus du tout maintenant», dit Christener à propos de sa cliente. Elle est désormais habituée à cela aussi. Tout comme le fait que la KESB ne peut jamais plaire à tout le monde. Soit elle agit trop tôt, soit trop tard, soit mal, soit elle n'aurait pas dû agir du tout.
«Chère KESB, vous nous avez beaucoup aidés. Sans vous, nous n'aurions pas trouvé de solution aussi rapidement. Merci».
Pourquoi Charlotte Christener s'engage-t-elle malgré tout dans ce travail ? Elle sourit et montre le mur de son bureau. Entre les dessins et les photos de ses enfants est accrochée une lettre anodine, juste quelques phrases : «Chère KESB, vous nous avez beaucoup aidés. Sans vous, nous n'aurions pas trouvé de solution aussi rapidement. Merci».
Tous les cas et toutes les personnes ont été modifiés par l'auteur de manière à ce qu'ils ne soient pas reconnaissables.
Qu'est-ce que la KESB ?
Le 1er janvier 2013, l'autorité professionnelle de protection de l'enfant et de l'adulte a remplacé les autorités de tutelle, où des non professionnels décidaient du sort des malades psychiques, des handicapés et des enfants dont les parents ne peuvent pas s'occuper. Des équipes interdisciplinaires composées de juristes, de psychologues, de pédagogues et de travailleurs sociaux sont désormais responsables de plus de 100 tâches administratives relevant du droit de la protection de l'enfant et de l'adulte. Les personnes nécessitant une protection reçoivent une curatelle qui leur est individuellement adaptée.
Cela entraîne des procédures plus lourdes. Ceci, ou encore les coûts que la KESB impose aux communes, suscite parfois des critiques massives.