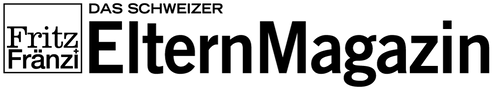André Stern, peut-on ne pas fixer de limites aux enfants ?
La salle du Maihof à Lucerne offre environ 480 places. Ceux qui n'ont pas trouvé de place libre se tiennent au bord, s'accroupissent, s'assoient sur le sol de pierre froid. Sur la scène se tient un homme, les cheveux longs attachés sur la nuque, chemise blanche, veste, écharpe à carreaux. André Stern écarte les bras, monte et descend sans cesse les quelques marches qui mènent à la salle de spectacle, s'agenouille devant les spectateurs, se relève - et ne reste presque jamais immobile. Pendant ce temps, il raconte ses expériences d'enfant, qui a acquis toutes les connaissances nécessaires partout, sauf à l'école. Il ne l'a jamais fréquentée, pas plus que ses fils ne le font aujourd'hui. André Stern parle de la valeur de l'enthousiasme des enfants, du jeu libre, du fait que tout se passe bien lorsque les parents laissent leurs enfants s'épanouir librement, les traitent d'égal à égal - et même, d'une certaine manière, ne les traitent pas comme des enfants. Non, il ne veut pas critiquer le système scolaire actuel, ni même l'abolir, mais seulement montrer, lui et ses propres enfants, que les choses peuvent aussi se passer autrement. Avec ce message, l'auteur de livres («... et je n'ai jamais été à l'école. Histoires d'un enfant heureux») et musicien remplit régulièrement des salles de conférence en France, en Autriche, en Allemagne et en Suisse.
Avant sa conférence au Maihof de Lucerne, André Stern a pris le temps de s'entretenir avec nous.
Monsieur Stern, vous semblez très en paix avec vous-même. Qu'est-ce que vos parents ont fait de bien ?
Je n'ai pas été éduqué à penser en termes de bien ou de mal, de bon ou de mauvais. Je ne fonctionne pas comme ça. Je ne me suis jamais comparée aux autres. Et cela - vous avez raison - je le dois à mes parents.

De quelle manière ?
Le problème, c'est que dès qu'il s'agit d'enfants, les gens partent de leur propre expérience : Qu'ai-je vécu moi-même avec mes parents ? Comment se sont-ils comportés avec moi ? Ou s'orienter vers des modèles et des concepts de soi-disant experts en éducation.
Vos parents ne l'ont pas fait ?
Non, ils sont partis de nous, les enfants.
C'est-à-dire ?
Vous vous êtes posé la question : Que recherche l'enfant ? Quels sont ses propres besoins ? Par exemple, ils n'ont pas envoyé ma sœur et moi à l'école parce qu'ils auraient souffert dans leur propre scolarité. Ils ont plutôt choisi de prendre en compte les besoins, les prédispositions et le rythme de leurs enfants, c'est-à-dire non pas contre, mais pour quelque chose.
Vous insistez toujours sur le fait que vous ne voulez gagner personne à une méthode d'éducation particulière. Pourtant, vous avez un message à faire passer ?
Je pense qu'une nouvelle attitude envers les enfants est nécessaire. Chaque être humain vient au monde avec les mêmes prédispositions et les mêmes besoins fondamentaux. Nous souhaitons tous être aimés et connectés, être nourris pour tous nos sens et avoir la possibilité de développer notre potentiel tout en étant autonomes. Nous possédons pour cela des capacités optimales, comme l'enthousiasme et l'ouverture d'esprit pour jouer, apprendre et découvrir tout au long de notre vie.
Vous parlez dans vos livres de l'écologie de l'enfance. Qu'entendez-vous par là ?
L'écologie de l'enfance est en fait une tentative de résumer cette nouvelle attitude envers l'enfant en un seul terme - une attitude basée sur l'attention et la confiance. Et avant que vous ne posiez la question : il n'y a pas une seule bonne attitude. J'ai déjà décrit celle de mes parents. Ils ne sont pas partis d'eux-mêmes, mais de nous, les enfants, ce qui m'a permis de me consacrer toute ma vie à mes prédispositions. Et, ce qui est très important, ils n'ont pas interrompu mon jeu et, surtout, ils l'ont pris au sérieux.
Quelle est l'importance du jeu chez l'enfant ?
Il est scientifiquement prouvé que nous retenons beaucoup plus facilement quelque chose si cela nous touche. Il ne faut donc en aucun cas briser la frénésie des enfants qui vont d'un enthousiasme à l'autre. Dans le jeu, l'enthousiasme est toujours présent, et ce n'est pas tout : en jouant, les enfants sont incroyablement persévérants et concentrés. L'enfant n'a pas encore fait de mauvaises expériences avec quelque chose de nouveau. Dans la relation entre les parents et leur enfant, il ne s'agit pas d'entraîner l'enfant à faire quelque chose, il s'agit bien plus de ne pas mettre de bâtons dans les roues de l'enfant. Ce que j'ai vécu, n'importe quel enfant le vivrait.
S'il n'allait pas à l'école ?
Si on le laissait s'exprimer librement.
On ne peut donc pas fixer de limites aux enfants ?
Je ne parlerais pas de limites. Mais je pense qu'il faut donner des repères à ses enfants. Une limite, c'est l'exercice du pouvoir, une orientation peut être un point de repère pour vivre ensemble. C'est une autre attitude. Rien ne justifie que l'on se comporte et que l'on communique différemment avec un enfant qu'avec son propre partenaire - par exemple lorsqu'il ne mange pas proprement. Vous ne dites pas non plus à votre mari : mange proprement, sinon tu vas dans ta chambre ! Si vous ne le dites pas à votre mari, il n'y a aucune raison que vous le disiez à votre enfant. Avec cette attitude, l'enfant peut continuer à se voir comme il est venu au monde : comme la bonne personne, au bon moment et au bon endroit.
Et nous, les adultes, nous ne le voyons pas comme cette personne ?
Pendant des siècles, nous sommes partis du principe que l'enfant venait au monde quasiment à l'état zéro, comme le point zéro du développement. L'adulte est la version Plus pleinement développée. Et l'éducation donnée par les parents et les enseignants fait de l'enfant un adulte viable au fil des ans. C'est en conséquence que nous nous sommes positionnés vis-à-vis des enfants.
(André Stern se lève, se place tout près de moi, les bras croisés, et me regarde de haut).
Alors, qu'est-ce que ça fait ? J'exerce mon pouvoir et je vous dis ce dont vous avez besoin ... C'est un peu désagréable, non ?
(Il rit et se rassoit).

Si je disais dans une conférence que les enfants ont besoin de limites, j'aurais 500 personnes dans la salle qui seraient plus ou moins d'accord. Mais pour démontrer à quel point cette position est obsolète, il me suffirait de remplacer le mot «enfants» par «femmes». Et je serais déjà moins bien accueilli.
Mais pour les enfants, c'est accepté ?
Nous ne prenons pas les enfants au sérieux, nous ne prenons pas leurs jeux au sérieux. Nous les percevons comme des nains qui ont besoin de notre éducation. Et c'est hautement discriminatoire. La plupart des enfants se trouvent symboliquement entre deux pôles.
(André Stern écarte les bras, regarde d'une main à l'autre).
D'une part, le pôle «Tel que je suis, je suis exactement comme il faut» et d'autre part, le pôle «Tu ne réponds pas à mes attentes». Et cette contradiction déchire l'enfant de l'intérieur, le rend malade. C'est pourquoi l'enfant tente de résoudre cette contradiction. Mais il ne peut pas changer le point de vue des adultes, il ne peut que changer le sien ...
... jusqu'à ce qu'il se sente aussi déficient que tous les adultes qui l'entourent ?
Et cela fait très, très mal à l'enfant - et ne le quitte plus pendant toute sa vie. Et vous savez quoi ? Presque tout le monde porte en lui un tel enfant blessé.
Mais soyons honnêtes : s'épanouir librement, sans règles, directives ni limites - d'autres ont déjà eu cette idée.
Ils font allusion au principe du laisser-faire de la génération 68, l'antithèse de la pédagogie noire (terme générique pour les méthodes d'éducation qui incluent la violence et l'intimidation comme méthodes). Dans les deux cas, il s'agit d'idées d'adultes qui sont imposées à l'enfant et qui ne lui conviennent donc pas. Ce n'est pas mon principe. Certes, je laisse faire mon fils Antonin et ne le corrige pas, mais je me préoccupe de ce qu'il fait, je participe.
Antonin a huit ans, à quoi s'intéresse-t-il le plus ?
Il est difficile de faire des catégories. Antonin s'imprègne littéralement du monde entier. Mais s'il fallait choisir un domaine qui le passionne particulièrement, ce serait l'espace. Il a déjà noué de nombreux contacts et s'est même fait un bon ami au sein de l'Agence spatiale européenne.
Comment l'avez-vous soutenu ?
Jusqu'à présent, je n'ai pas eu à faire quoi que ce soit. Dès que l'on s'intéresse à quelque chose, le monde entier conspire.
C'est-à-dire ?
Dans son cas, cela signifie qu'il rencontre quelqu'un qui dit : «Je connais un ingénieur et je le mets en contact. Je peux ainsi créer un lien qui sera précieux pour tous les deux». Cet ingénieur est un grand enrichissement pour Antonin, tout comme Antonin est un grand enrichissement pour lui. Il le reconnecte à son ancien enthousiasme pour son métier. Le petit garçon pose au scientifique des questions auxquelles il ne sait peut-être pas répondre et auxquelles il doit réfléchir. Lorsque l'enfant sort dans le vaste monde, il rencontre d'autres personnes avec lesquelles il se lie. Qu'il s'agisse d'enfants ou d'adultes, cela n'a pas d'importance, il rencontre des intérêts communs. L'enfant n'a aucune raison de s'identifier à un groupe d'âge.
Quand vous étiez enfant, aviez-vous des amis du même âge qui allaient à l'école ?
Bien sûr.
En quoi vous distinguiez-vous de vos amis du même âge lorsque vous étiez enfant ?
Pas du tout. Notre monde est un monde éblouissant de différences. On se sent indispensable et unique au milieu de ces différences. C'est ainsi que les enfants nous montrent l'exemple de ce que serait un monde meilleur, car ils ne connaissent pas de hiérarchie entre les personnes ni entre les professions. Ils n'ont pas besoin d'apprendre la tolérance, car ils ne connaissent pas l'intolérance.
Que fait votre femme dans la vie ?
Pauline est actrice. Nous sommes toutes les deux souvent en déplacement, mais je travaille aussi souvent à la maison. Pourquoi demander ?
Pour permettre à ses enfants de vivre ce que vous permettez à vos enfants, il faut bien au moins un parent qui ne travaille pas, mais qui est à la maison ?
Chez nous, il y a toujours quelqu'un à la maison. Nous vivons avec mes parents et ma sœur. Mais tout d'abord, il ne s'agit pas de «garder l'enfant à la maison», mais de le laisser choisir lui-même les chemins qu'il va emprunter. L'enfant veut partir dans le vaste monde. Cela exige que l'on soit là en tant que père et mère. Mais pas géographiquement. La seule chose à laquelle les parents doivent veiller, c'est de donner à leur enfant un havre de paix. C'est l'endroit où l'on dit à l'enfant : «Je t'aime parce que tu es comme tu es». Ainsi, l'enfant n'a pas besoin de couvrir ses véritables qualités avec des concepts ou des idées quelconques que ses parents, ses enseignants ou ses éducateurs ont de lui. Il reste ce qu'il est : un géant. Ce qui est passionnant, c'est que si vous vivez vraiment cette nouvelle attitude, le terme d'enfance disparaît en fait. Car ce terme vient de nous, les adultes. Et nous, les adultes, nous enfermons nos enfants dans un ghetto, le ghetto de l'enfance.
Cela semble très dramatique. Ne surchargez-vous pas les enfants ?
Comment la liberté peut-elle être trop exigeante ? Elle ne vous dépasse que si vous n'y êtes pas habitué. On ne peut pas être trop libre.
L'une de vos activités consiste à conseiller les enseignants. Que leur dites-vous ?
Il y a deux choses que les enseignants aiment retenir de leurs entretiens avec moi. Premièrement, la nouvelle attitude : «Je t'aime parce que tu es comme tu es». Si l'on rencontre l'enfant de cette manière, il s'en souviendra encore dans 50 ans, et cela enlève toute la pression. L'autre chose, c'est l'enthousiasme donné en exemple. De nombreux enseignants se plaignent auprès de moi, les larmes aux yeux, et me demandent comment ils peuvent à nouveau enthousiasmer leurs élèves.
Que leur répondez-vous ?
Avec tes larmes, tu peux les toucher, mais pas les enthousiasmer. Nous devons être conscients qu'en tant qu'adultes, nous sommes constamment des modèles pour les enfants.

Récemment, ma fille de cinq ans a enfilé son justaucorps de danse, a préparé son livre de ballet pour enfants et a commencé à reproduire les représentations. Elle était complètement absorbée par son jeu. Mais nous avions un rendez-vous et devions partir.
Avez-vous interrompu son jeu ?
Oui, et ça ne m'a pas fait du bien.
Alors pourquoi le faire ?

Peut-être parce que l'on a soi-même grandi ainsi. Parce que l'on froisserait l'autre si l'on annulait un rendez-vous à la dernière minute.
C'est le poids de notre culture. Et je ne sais pas comment vous pouvez résoudre ce conflit. Peut-être trouverez-vous une bonne forme de communication avec votre fille, en lui disant : «Ecoute, nous avons maintenant cet accord que nous voulons respecter. Il y en aura toujours dans la vie. Mais après, tu peux continuer à jouer». Les enfants doivent avoir la certitude qu'ils peuvent reprendre leur jeu sans interruption, ils peuvent alors bien vivre avec les interruptions. J'ai eu cette certitude, mes fils l'ont aussi.
La plupart des enfants d'aujourd'hui ont-ils trop de rendez-vous (obligatoires) ?
Malheureusement. Les enfants peuvent très bien gérer la frustration et le stress tant que ces moments ne prennent pas le dessus. Mais le «non» prédomine trop dans la vie d'un enfant.
De nombreux parents se plaignent aujourd'hui de la consommation médiatique de leurs enfants.
Le vrai problème, c'est que pour la plupart des enfants, le monde réel n'est pas aussi appétissant que le monde virtuel, c'est pourquoi ils y plongent. Dans le jeu vidéo, ta couleur de peau, tes résultats scolaires et ton sexe ne jouent aucun rôle. Dans le monde virtuel, tu es un héros. Tu peux jouer, et ce absolument librement, parce que les parents ne comprennent absolument pas ce qui se passe. Si nous voyons que nos enfants plongent dans le monde virtuel parce que c'est le seul endroit où ils ont ces libertés, nous devrions faire en sorte qu'ils se sentent à nouveau plus à l'aise dans le monde réel, c'est-à-dire chez nous.
Suggestions de livres
- André Stern : «Jouer pour sentir, apprendre et vivre» Éditions Elisabeth Sandmann 2016, 144 pages, env. 32 francs
- André Stern : "... et je n'ai jamais été à l'école. Histoires d'un enfant heureux" ZS Verlag 2009, 182 pages, env. 25 francs
Lire la suite :
- Monsieur Largo, que manque-t-il dans notre système éducatif ?
- L'idéal de la famille nucléaire épuise les mères, explique la politologue Mariam Irene Tazi-Preve dans un entretien.
- À quoi pourrait ressembler l'école du futur ? Une approche